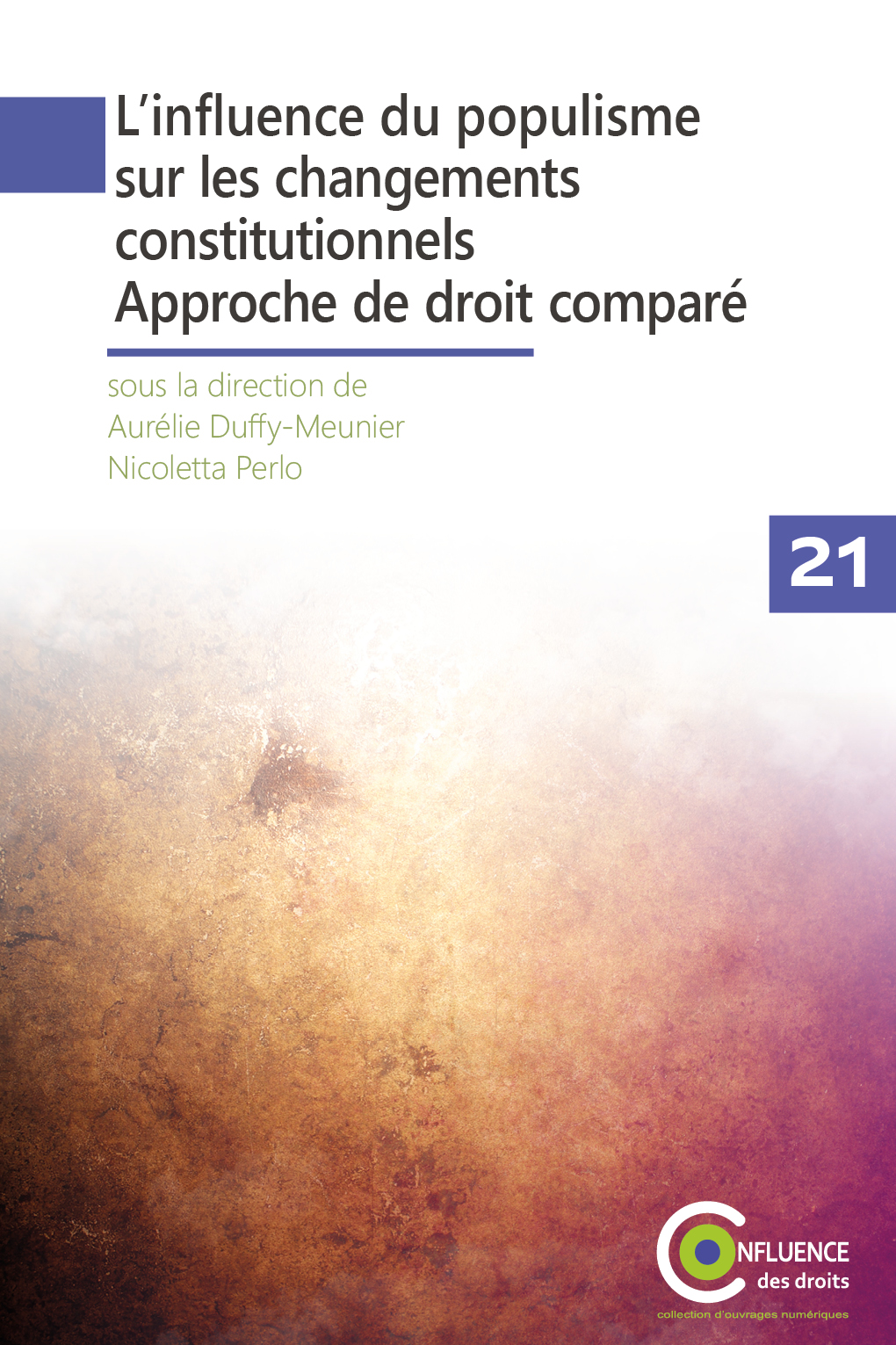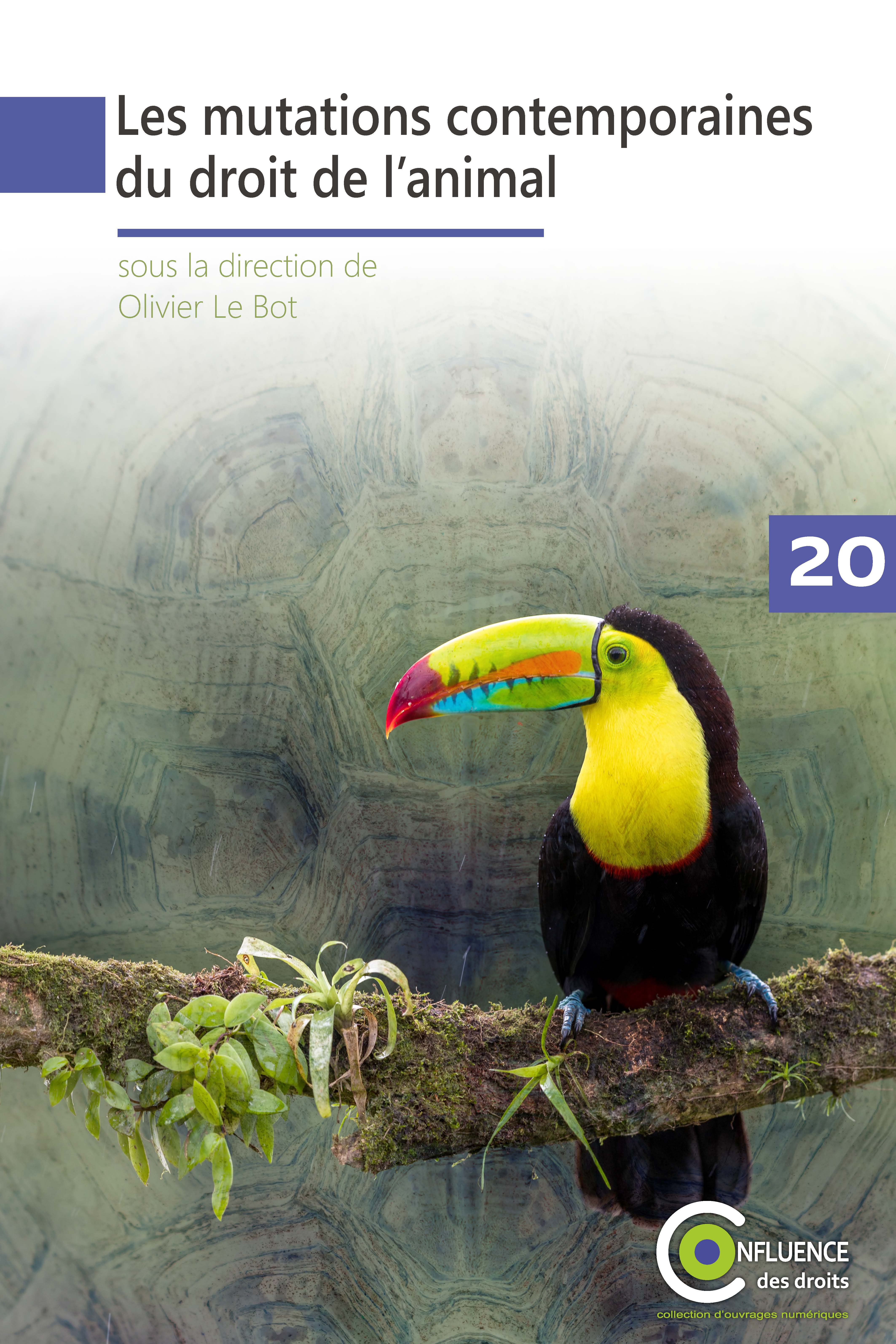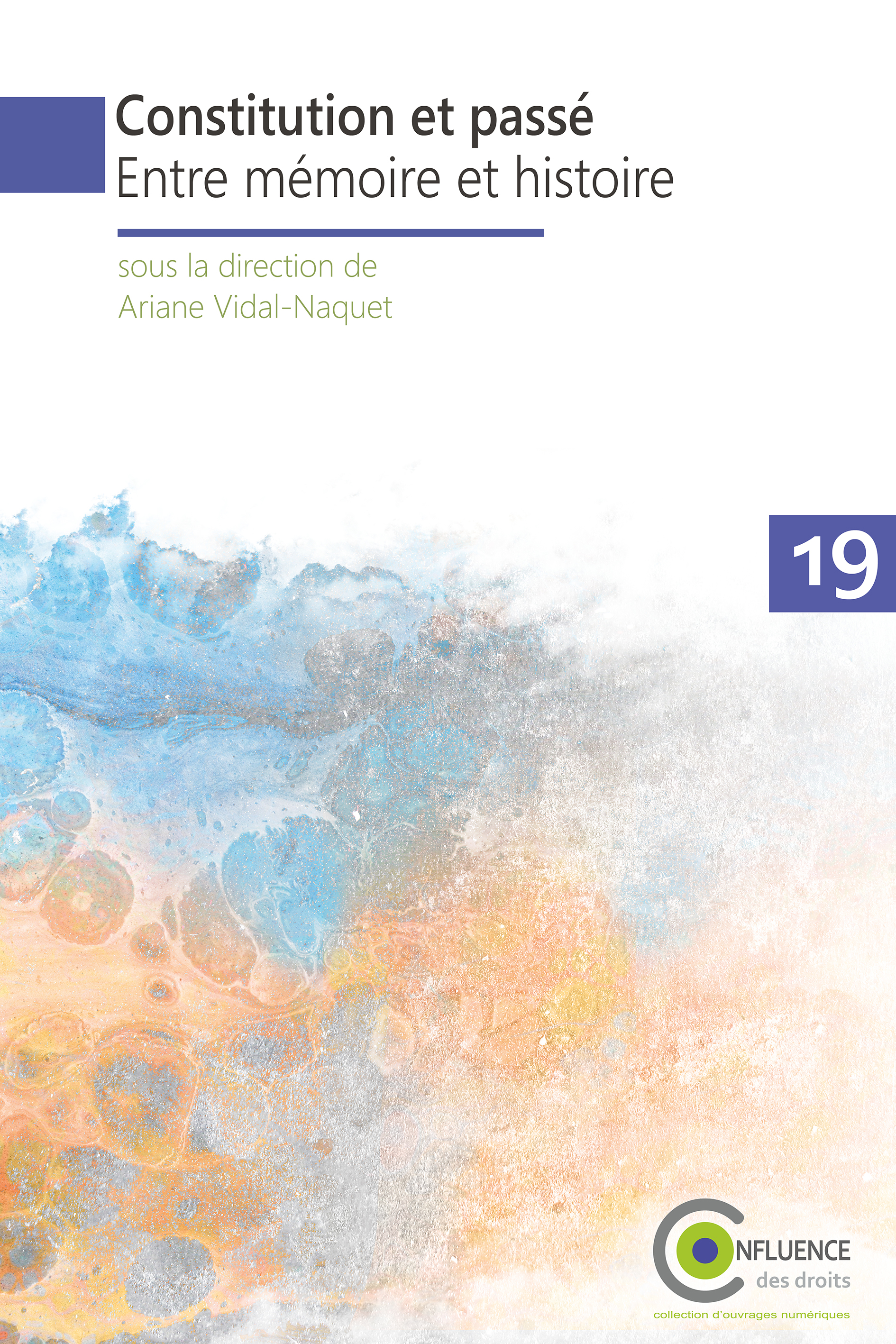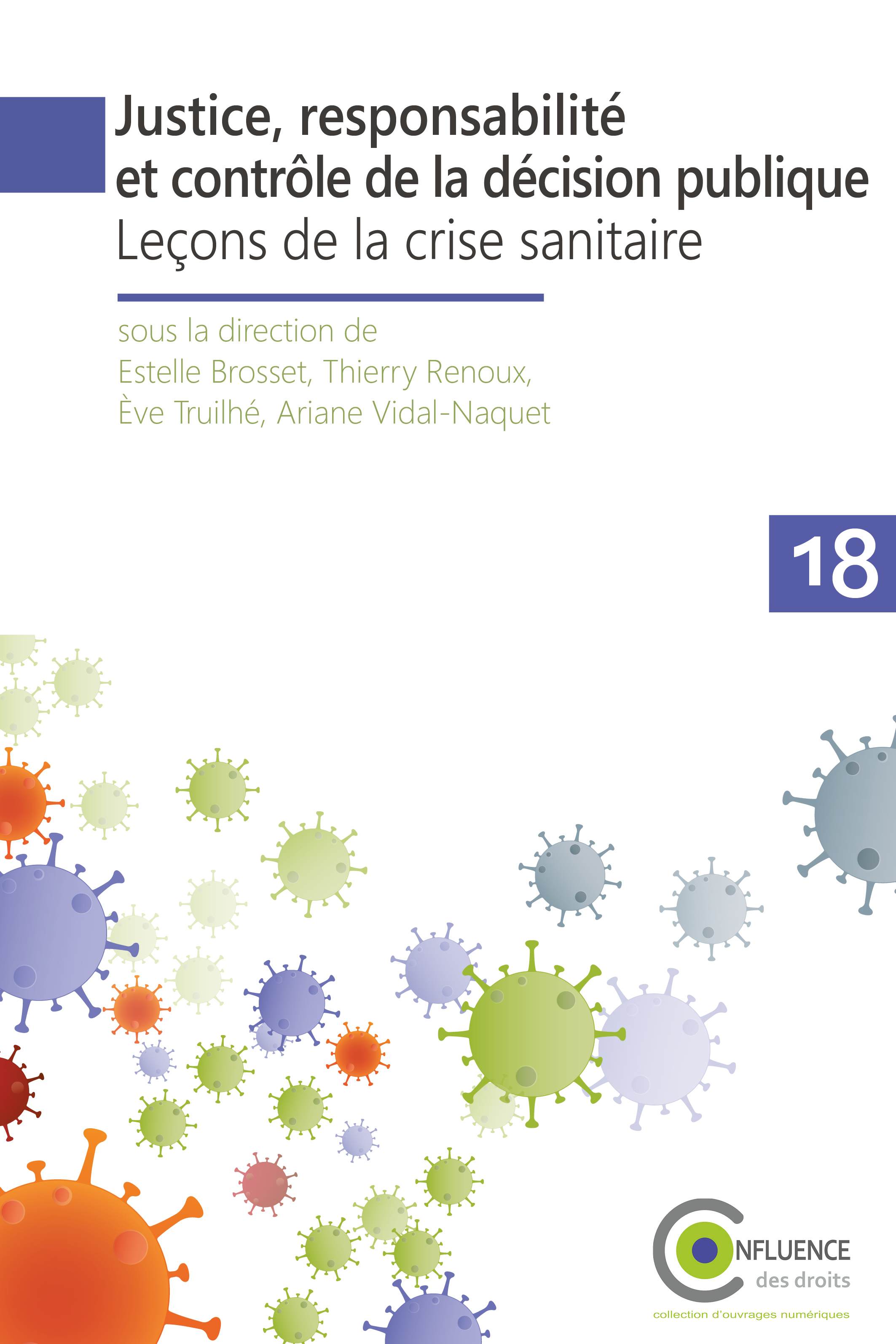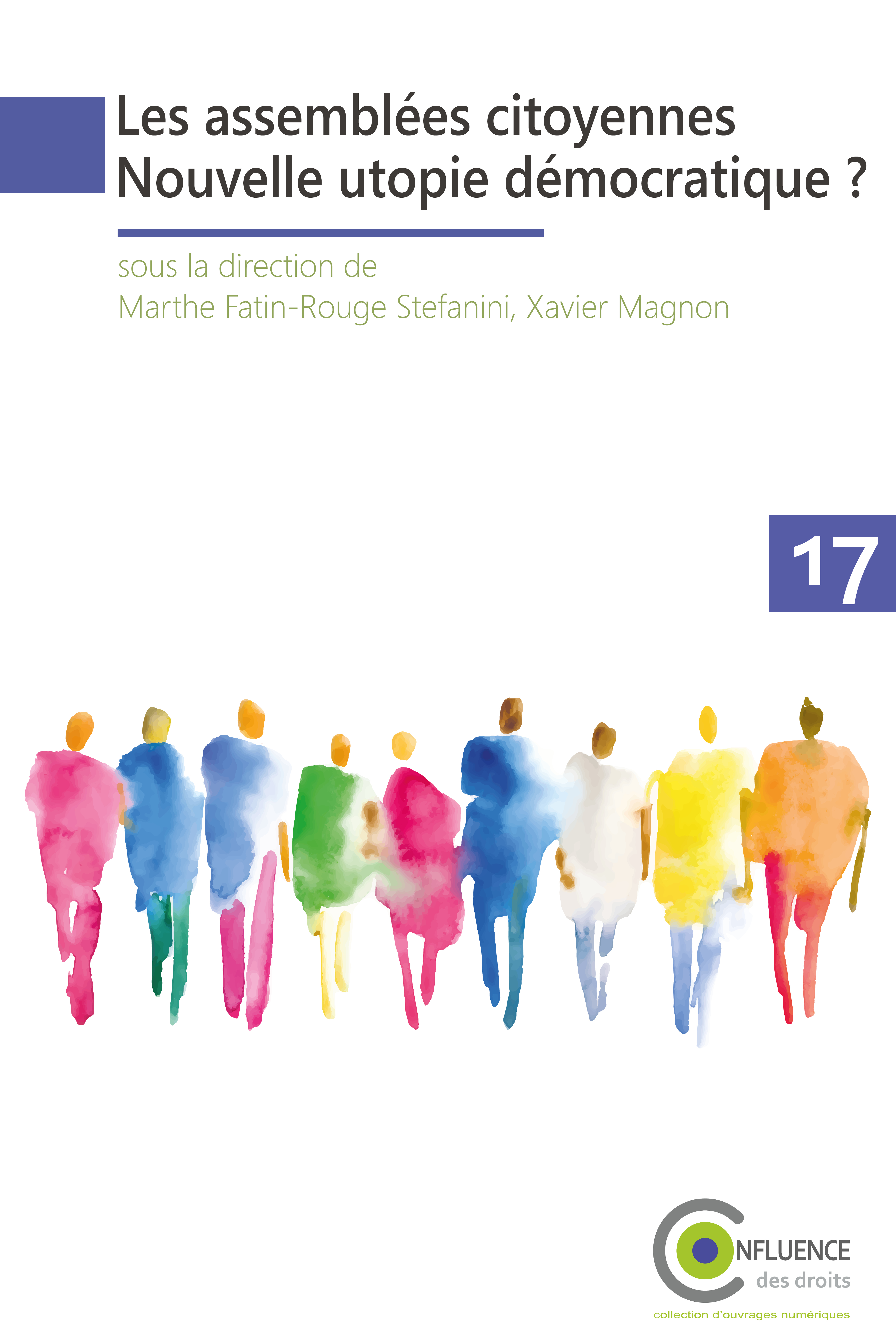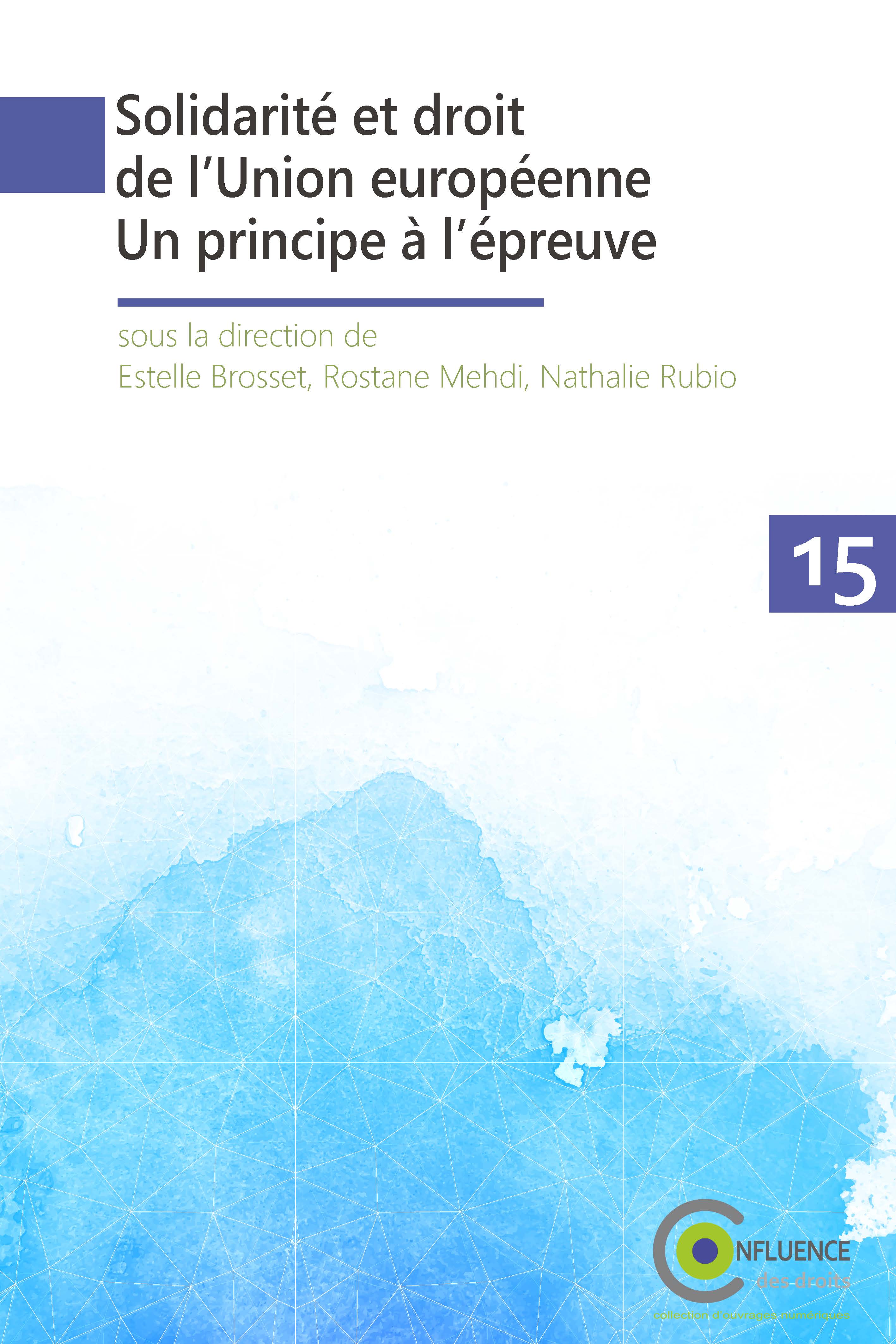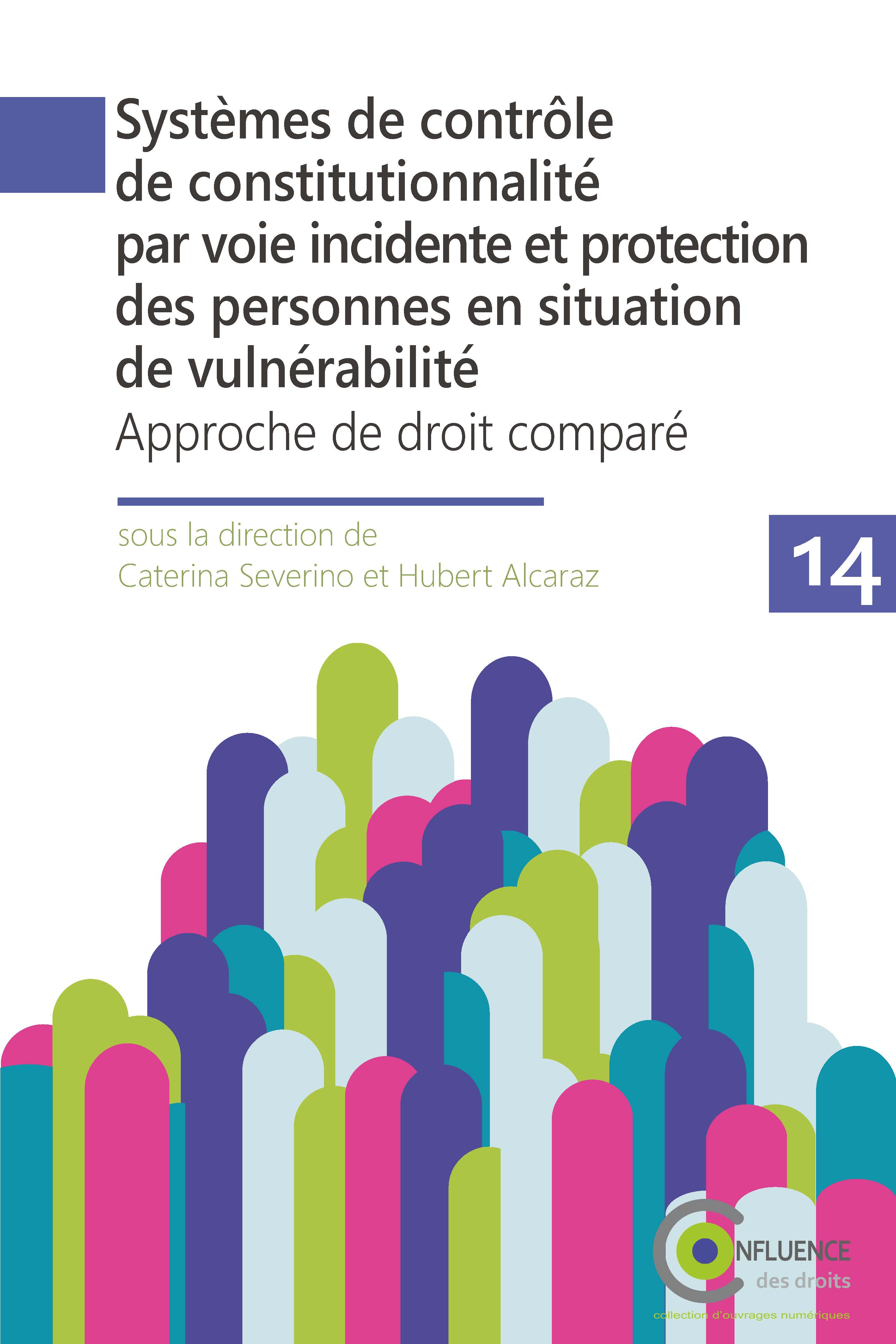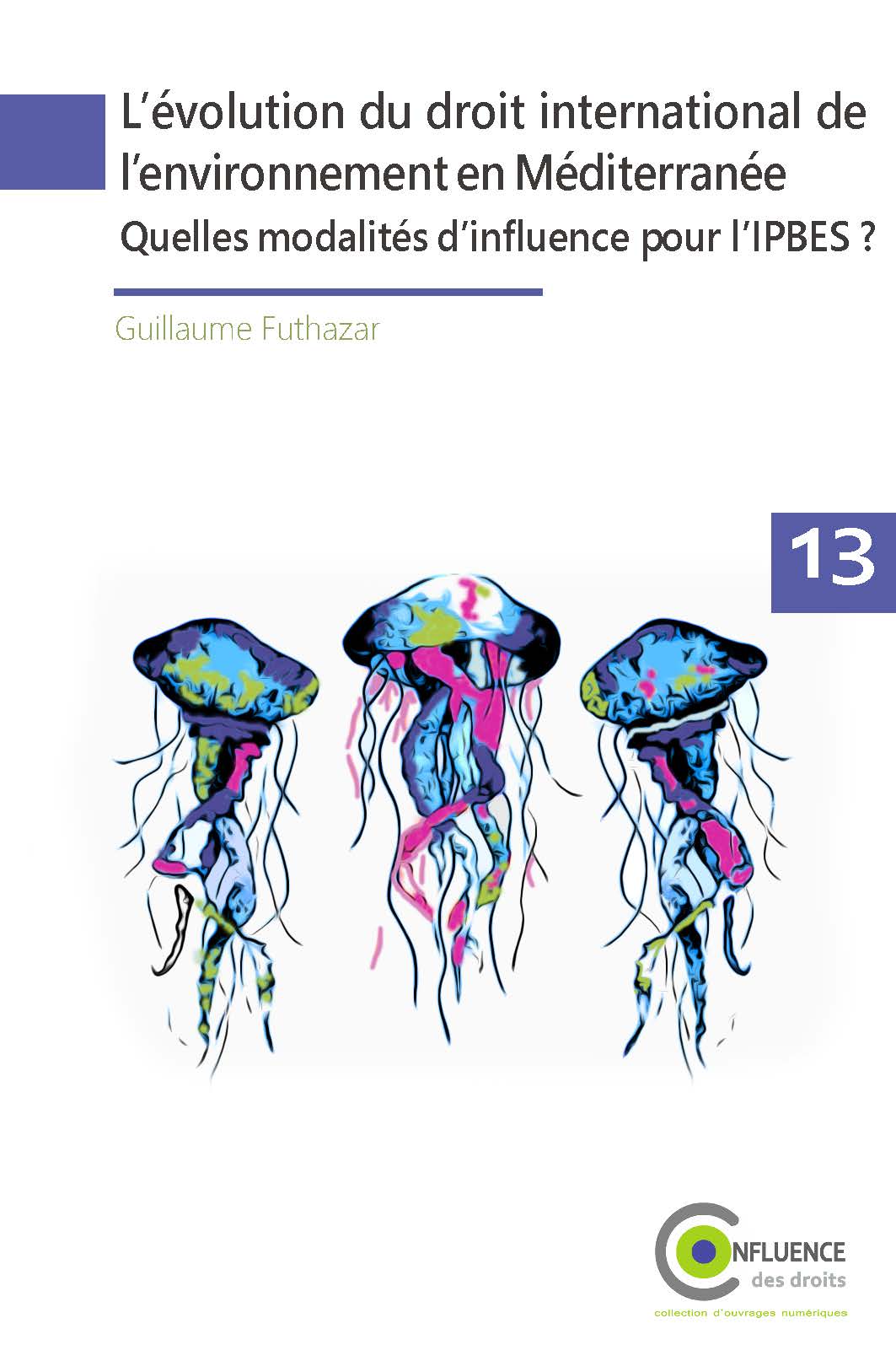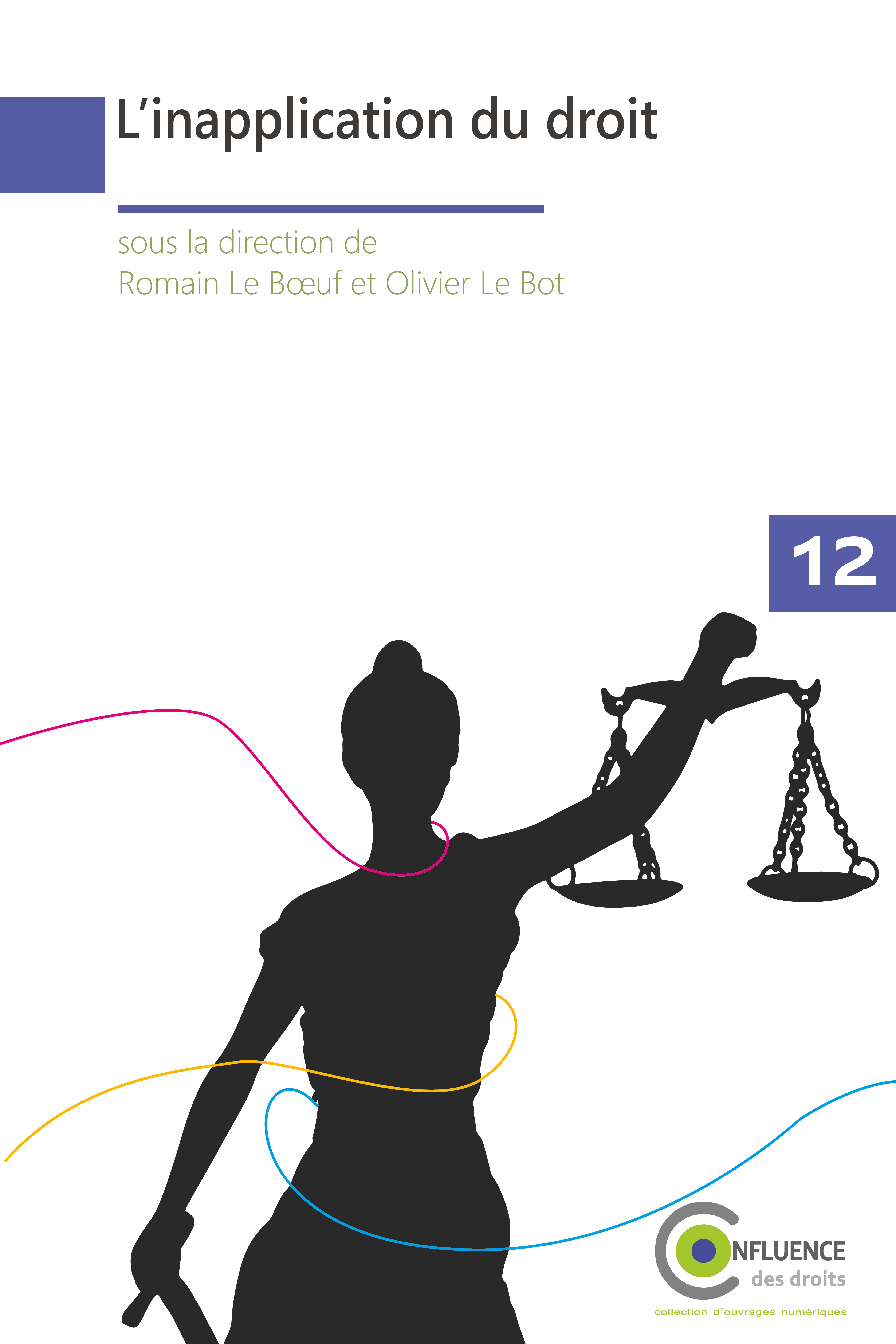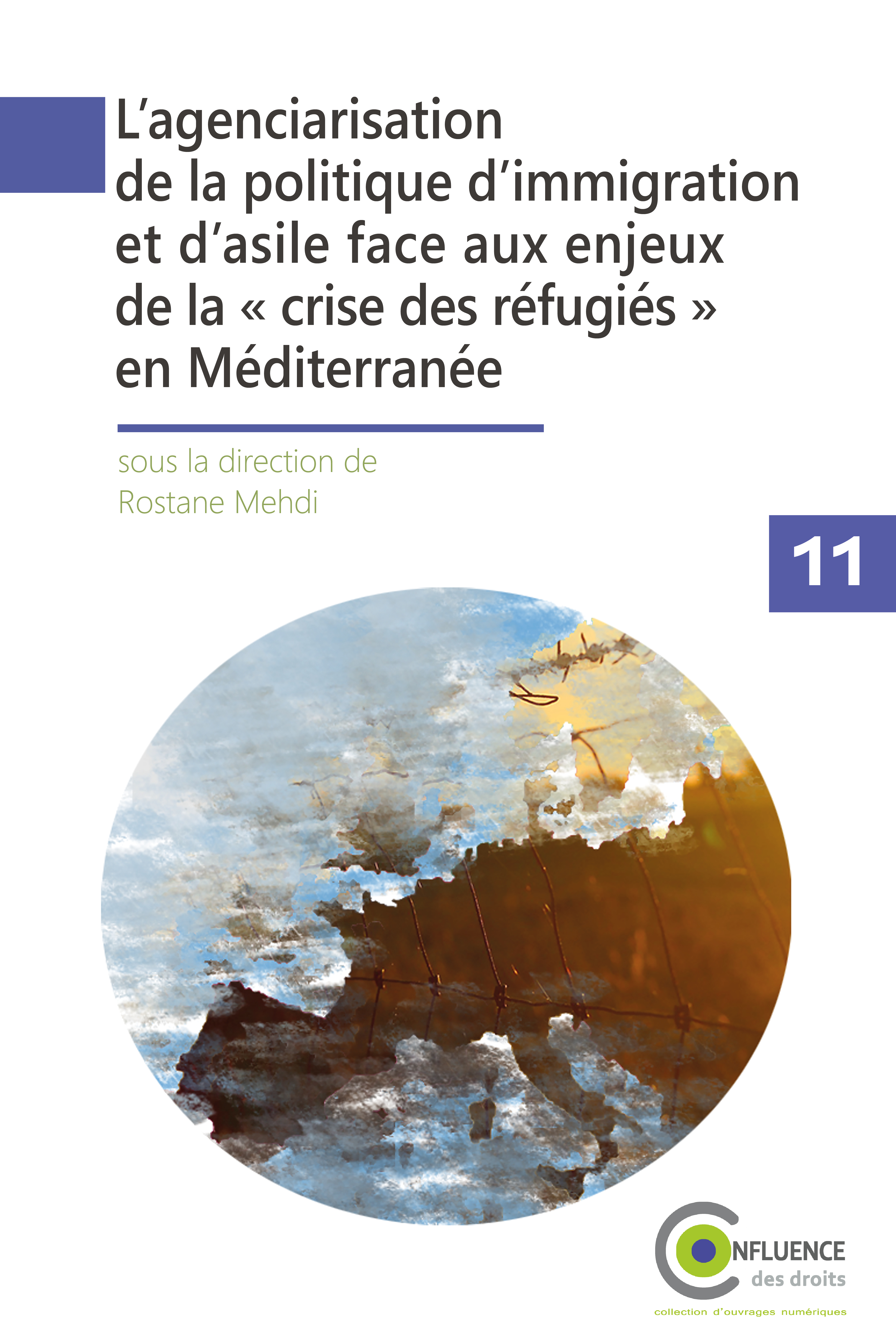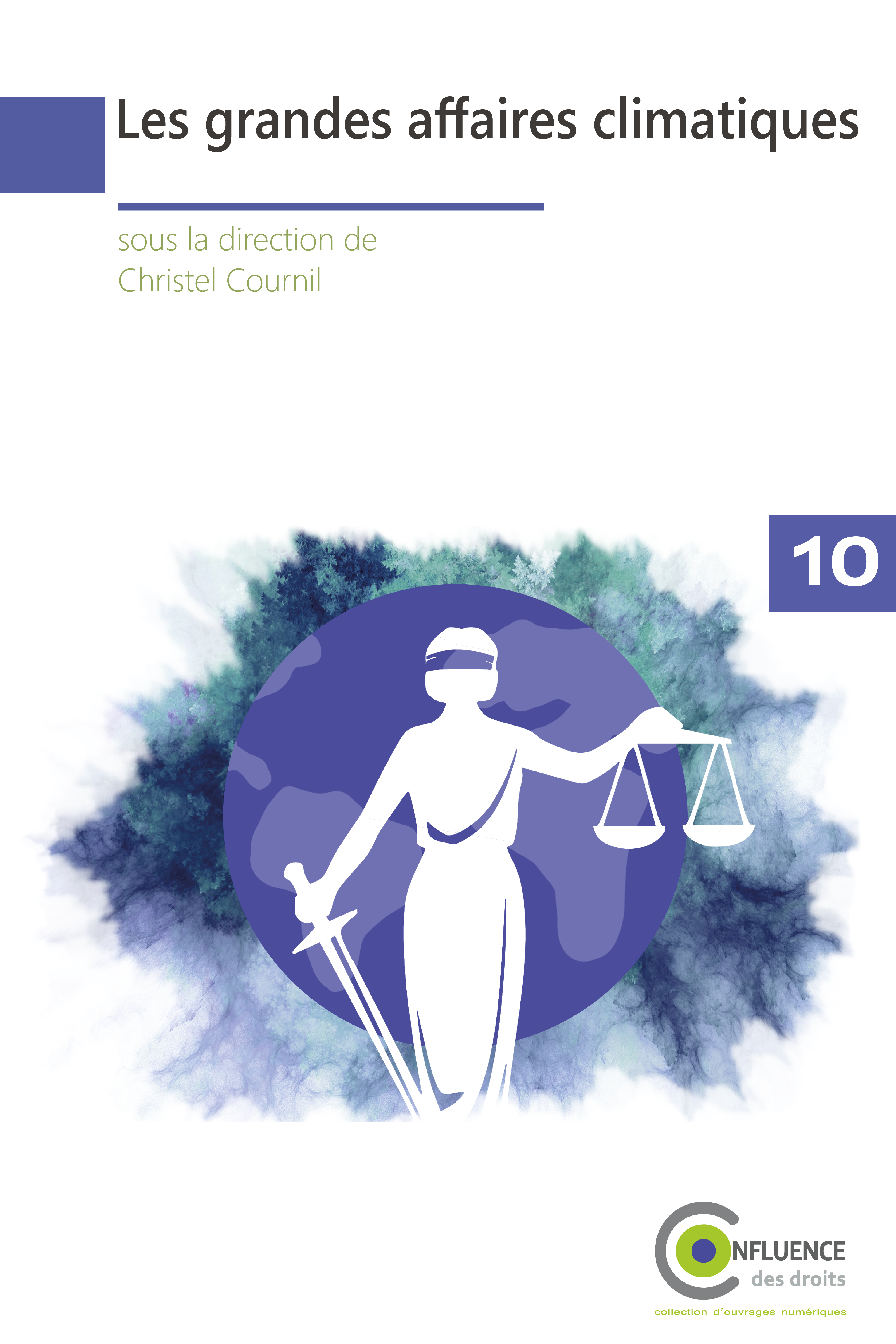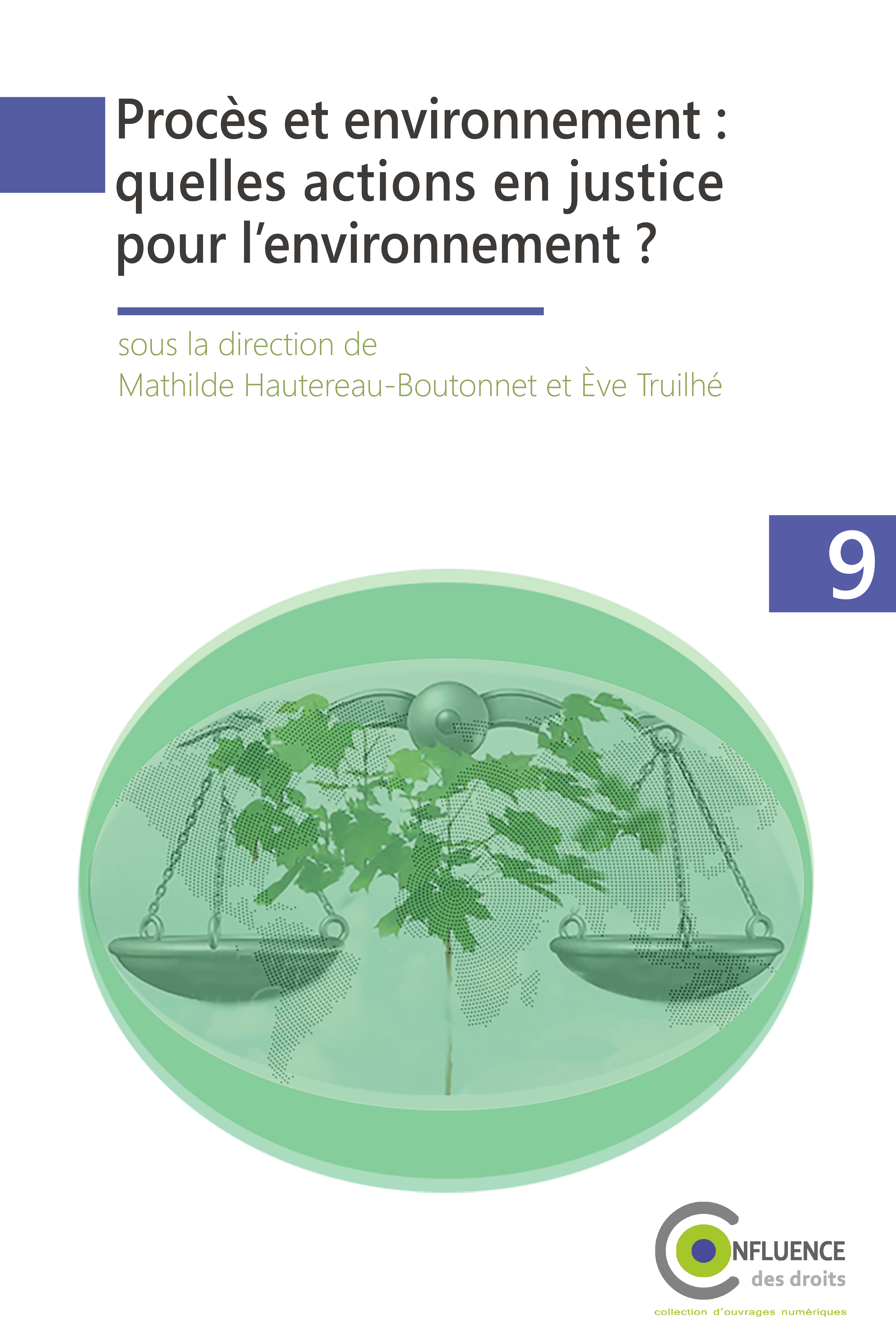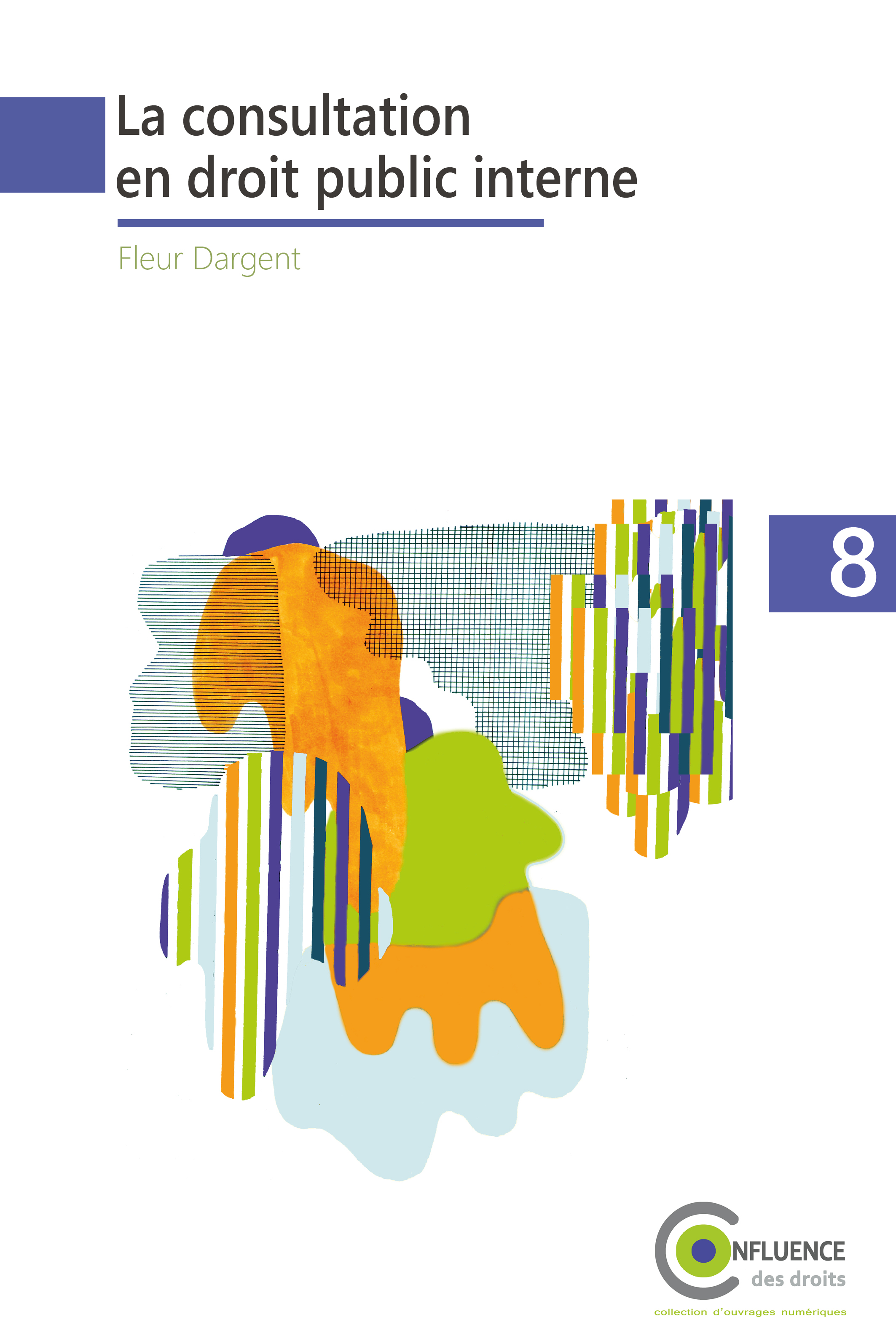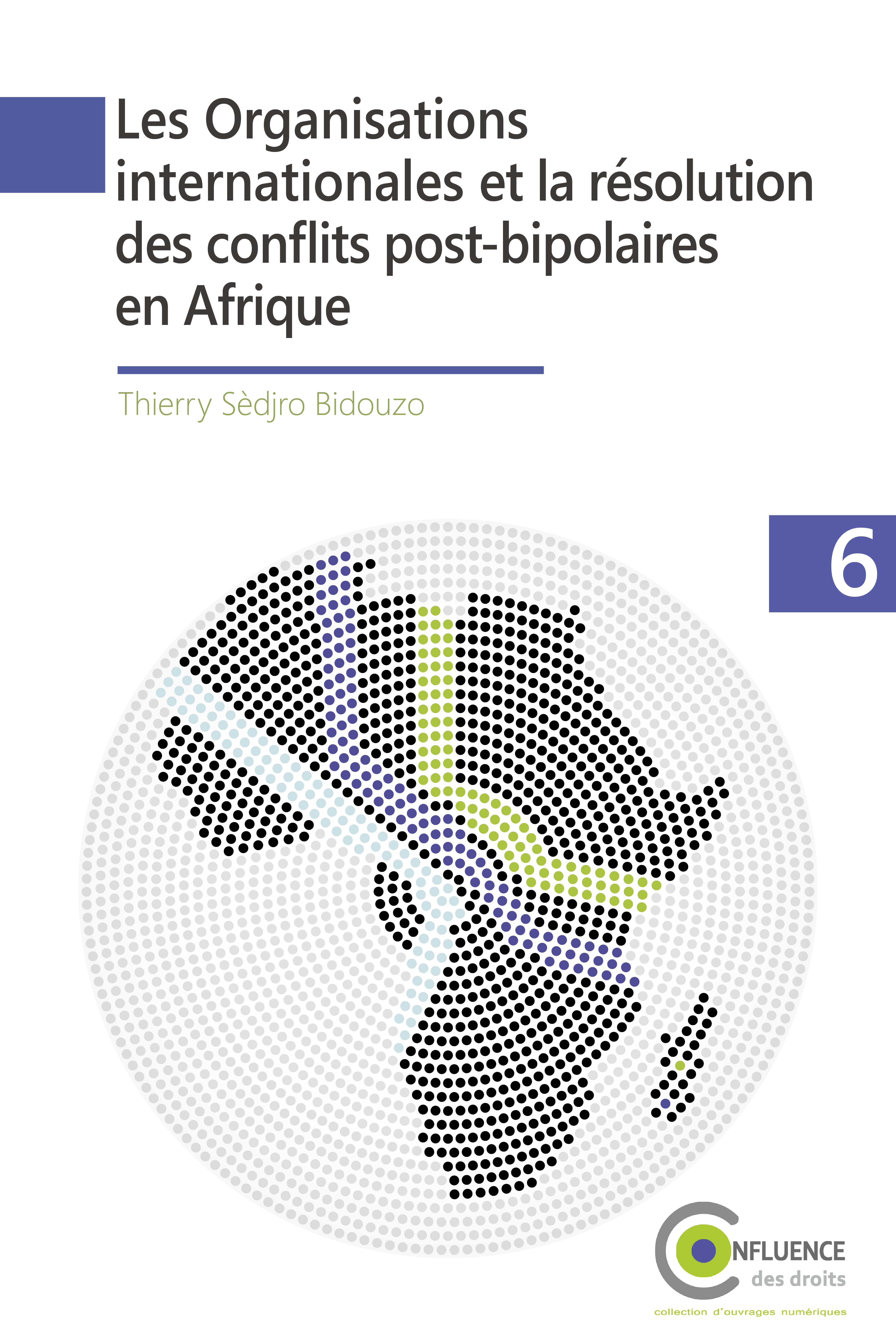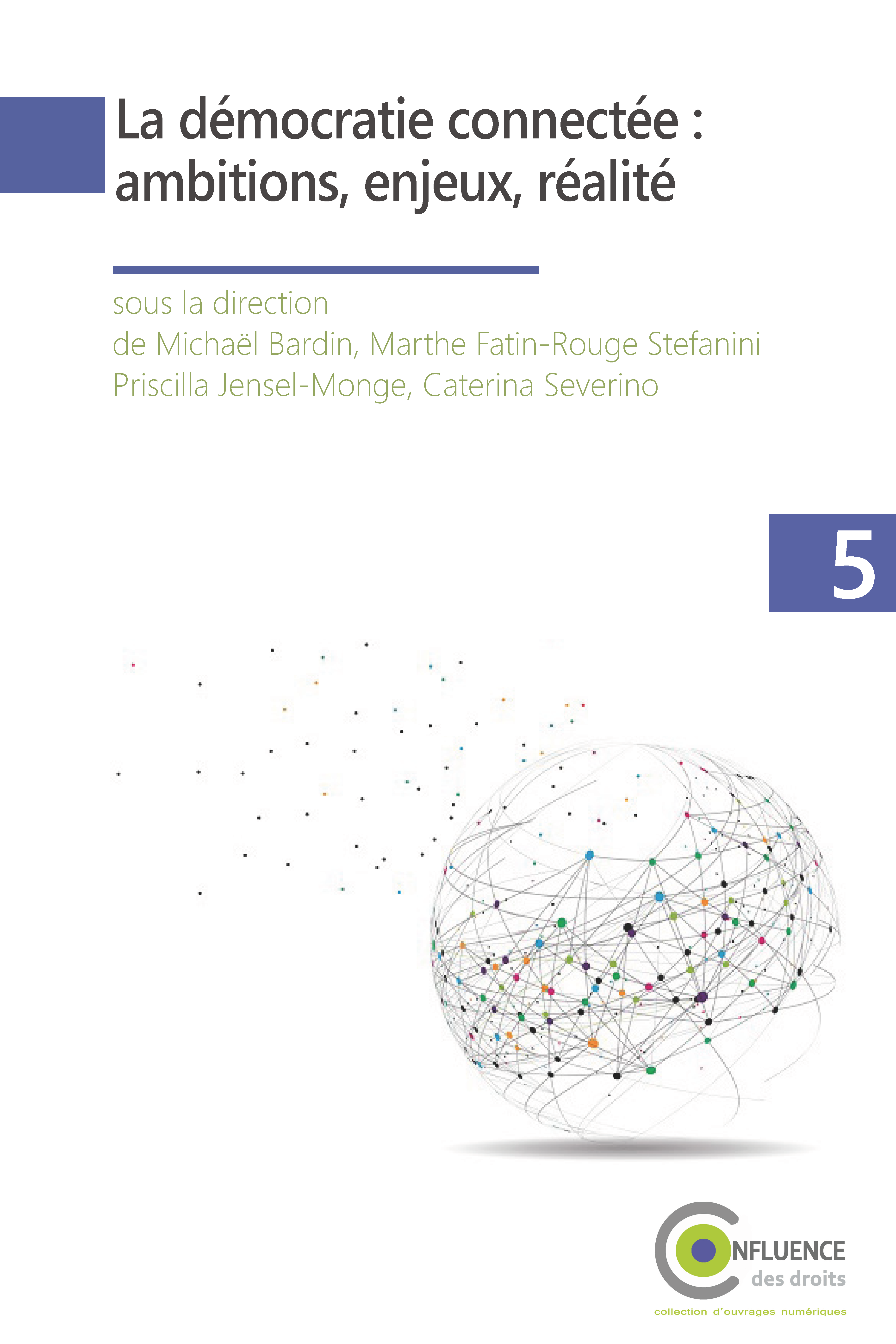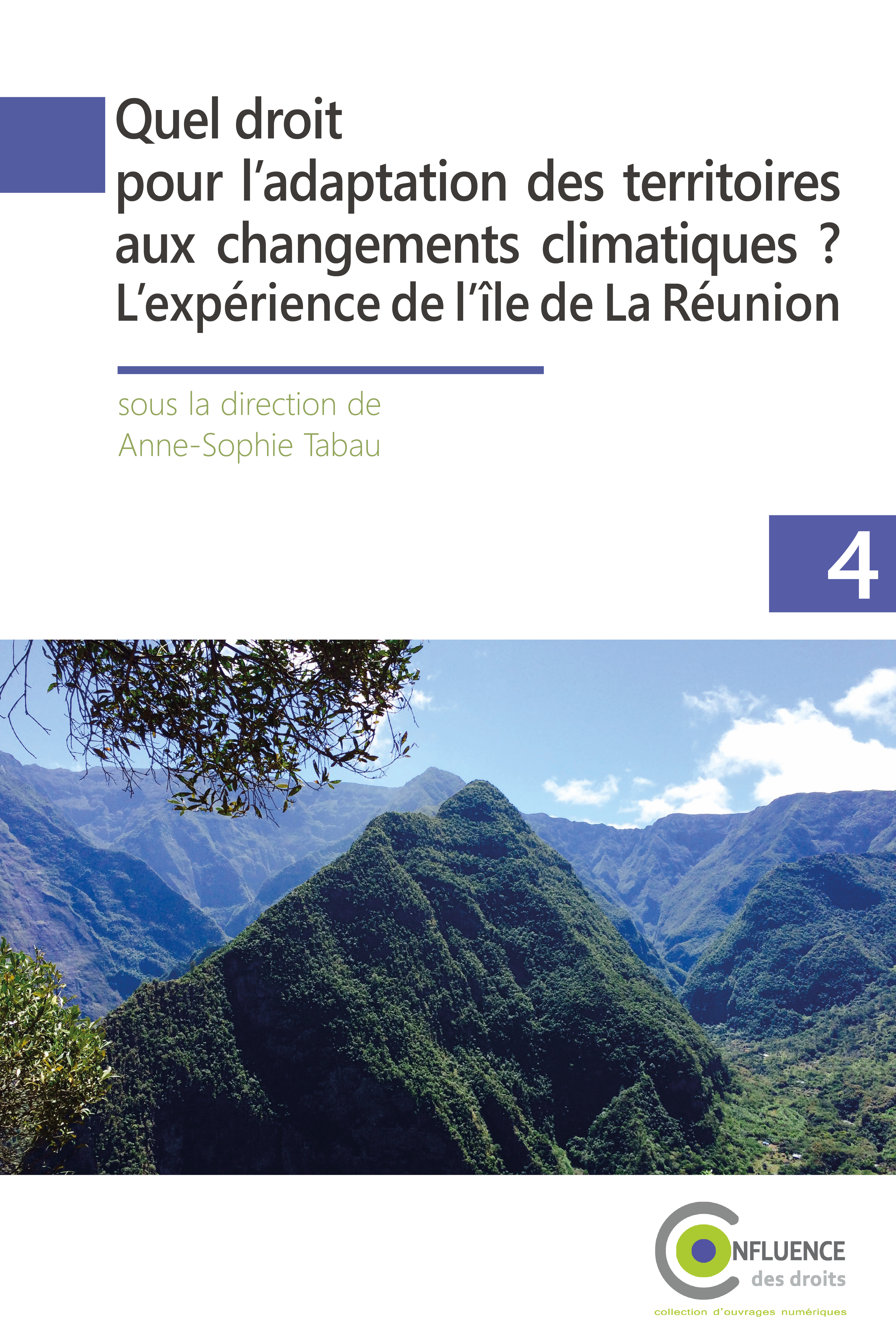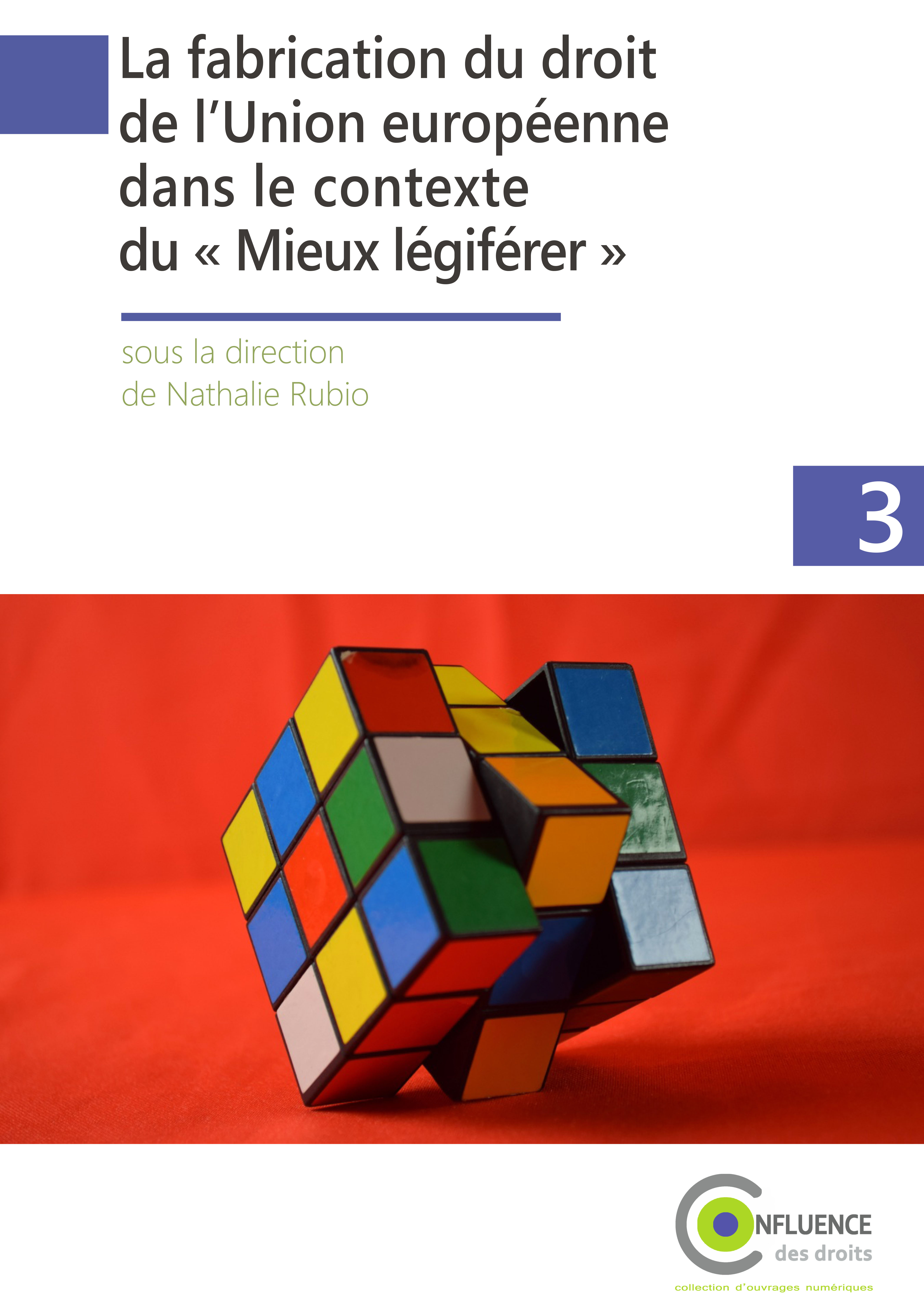Toute la collection d'ouvrages "Confluence des droits" figure sur OpenEdition Books https://books.openedition.org/dice/
21. L’influence du populisme sur les changements constitutionnels Approche de droit comparé
Aurélie Duffy-Meunier et Nicoletta Perlo (dir.)
236 p., 1e trimestre 2024
ISBN : 979-10-97578-21-3

Pour accéder à l'ouvrage dans sa version intégrale, cliquer sur ce lien
Pour retrouver l'ouvrage sur OpenEdition Books : cliquer sur ce lien
DOI : https://doi.org/10.4000/books.dice.15447
Le populisme se développe dans des pays qui relèvent de tous les continents. Malgré son caractère multiforme rendant difficile son appréhension, le populisme se caractérise par certaines constantes qui ont été analysées du point de vue de la science politique, mais très peu sous un angle juridique, pluridisciplinaire et de droit comparé. Du Mouvement 5 étoiles en passant par le péronisme et le castrisme, les mouvements populistes séparent la société en deux groupes antagonistes : d’un côté́ une élite corrompue, de l’autre le peuple pur, doté d’une légitimité́ supérieure. Par conséquent, le phénomène populiste refuse toute institution représentative et de garantie de l’État de droit – le Parlement, les Cours constitutionnelles, la magistrature – pouvant concurrencer un leader, seul représentant légitime du peuple. Le populisme remet ainsi en cause le constitutionnalisme et ses valeurs en produisant tant des changements constitutionnels formels qu’informels. Dans cet ouvrage, des chercheurs nationaux et étrangers ont croisé leurs regards sur les transformations des institutions démocratiques représentatives, sur les révisions constitutionnelles ou les conventions constitutionnelles suscitées par les populismes ainsi que sur les réactions des institutions à de telles transformations. Cet ouvrage entend ainsi apporter un éclairage renouvelé sur la question de la confrontation du populisme et des différentes formes de constitutionnalisme dans des pays européens, du continent américain et en Russie.
Pour découvrir la table des matières, cliquer ici
20. Les mutations contemporaines du droit de l'animal
Olivier Le Bot (dir.)
323 p., 3e trimestre 2023
ISBN : 979-10-97578-19-0

Pour accéder à l'ouvrage dans sa version intégrale, cliquer sur ce lien
Pour retrouver l'ouvrage sur OpenEdition Books : cliquer sur ce lien
DOI : https://doi.org/10.4000/books.dice.14870
Le droit de l’animal a connu des mutations d’ampleur au cours des vingt dernières années. Il s’est structuré en champ disciplinaire autonome, a pris une importance croissante dans le débat public et a fait l’objet de réformes remarquées.
Le présent ouvrage rend compte de ces évolutions en publiant les actes d’une université d’automne qui s’est tenue à la faculté de droit d’Aix-en-Provence en octobre 2021.
Il rassemble les contributions des auteurs – uristes, politistes et historiens – autour de sept thématiques : le droit de l’animal comme champ disciplinaire ; les mots du droit de l’animal ; la fabrique du droit de l’animal ; droit de l’animal et participation démocratique ; droit de l’animal, droits fondamentaux et droit constitutionnel ; la représentation des animaux devant les juridictions et l’action au nom et pour le compte d’un animal ; juridictions pénales et animaux.
Le lecteur pourra apprécier, en les parcourant, l’intérêt et la richesse d’une matière en plein essor, particulièrement en phase avec les préoccupations de son temps.
Pour découvrir le sommaire, cliquer ici
19. Constitution et passé. Entre mémoire et histoire
Ariane Vidal-Naquet (dir.)
174 p., 1e trimestre 2023
ISBN : 979-10-97578-18-3

Pour accéder à l'ouvrage dans sa version intégrale, cliquer sur ce lien
Pour retrouver l'ouvrage sur OpenEdition Books : cliquer sur ce lien
DOI : https://doi.org/10.4000/books.dice.13177
Issu d’une journée d’études qui s’est tenue à Aix-Marseille Université en 2020, le présent ouvrage propose des réflexions sur les rapports que la Constitution entretient avec le passé, sur la façon dont elle le représente, l’appréhende, le traite voire l’utilise. Ce thème, abordé par les jeunes chercheurs de l’Institut Louis Favoreu sous le parrainage de chercheurs expérimentés, trouve, dans l’actualité, des résonances importantes avec, par exemple, la multiplication des lois mémorielles et des devoirs de mémoire, les débats soulevés par une « cancel culture » constitutionnelle ou encore la constitutionnalisation de « vérités » historiques.
Les différentes contributions analysent, dans une perspective historique et comparée, la façon dont la Constitution/les Constitutions se saisissent du passé : à cet égard, elles soulignent la diversité des manières de représenter le passé voire de se l’approprier et interrogent la spécificité du discours constitutionnel sur le passé. Elles analysent également la façon dont la/les Constitutions utilisent le passé, comment ce dernier intervient au soutien de la construction du récit constitutionnel et comment il peut être mobilisé par les différents acteurs constitutionnels, notamment le juge.
Pour découvrir le sommaire, cliquer ici
18. Justice, responsabilité et contrôle de la décision publique
Estelle Brosset, Thierry Renoux, Ève Truilhé et Ariane Vidal-Naquet (dir.)
204 p., 4e trimestre 2022
ISBN : 979-10-97578-17-6

Pour accéder à l'ouvrage dans sa version intégrale, cliquer sur ce lien
Pour retrouver l'ouvrage sur OpenEdition Books : cliquer sur ce lien
DOI : https://doi.org/10.4000/books.dice.12353
La crise sanitaire que nous traversons, sans doute encore davantage que les autres crises sanitaires avant elle, au-delà des adaptations en droit qu’elle a imposées, a mis et met encore à l’épreuve ce que le droit prévoit en matière de contrôle de la décision publique. Elle en souligne les potentialités mais aussi les limites et invite, peut-être, à repenser les mécanismes qui le caractérisent ou les concepts qui le sous-tendent. Il s’agira ainsi de tirer les leçons de la crise sanitaire en envisageant, en droit, la question de la responsabilité et le contrôle de la décision publique (son objet comme ses modalités) par les citoyens et tous ceux qui s’expriment en leur nom, qu’il s’agisse des parlements ou de la justice.
Pour découvrir le sommaire, cliquer ici
17. Les assemblées citoyennes - Nouvelle utopie démocratique?
Marthe Fatin-Rouge Stefanini, Xavier Magnon
303 p., 2e trimestre 2022
ISBN : 979-10-97578-16-9

Pour accéder à l'ouvrage dans sa version intégrale, cliquer sur ce lien
Pour retrouver l'ouvrage sur OpenEdition Books : cliquer sur ce lien
DOI : https://doi.org/10.4000/books.dice.10440
Si l’actualité des assemblées citoyennes est relativement récente en France, avec la Convention citoyenne pour le climat, cette technique s’appuie sur de nombreuses et anciennes expériences dans d’autres États. L’étude de ces assemblées a également fait l’objet de nombreux travaux issus de la science politique en France comme à l’étranger. Les juristes demeurent, encore aujourd’hui, largement étrangers à cette réflexion, aussi bien dans sa dimension pratique, l’étude de la pratique des assemblées citoyennes, que dans sa dimension théorique, sous l’angle de l’étude des concepts de démocratie délibérative et de démocratie participative. Dans un tel contexte, le présent ouvrage, Les assemblées citoyennes : nouvelle utopie démocratique ?, résultat d’un colloque international pluridisciplinaire, permet de dresser un état des lieux, sous un angle critique, de ce qu’il convient de penser des assemblées citoyennes. Les assemblées citoyennes constituent-elles le remède miracle à la crise du régime représentatif ? Tel est, sans doute le fil rouge de toutes les questions soulevées au cours de cette journée d’études. Quel est le sens des « assemblées citoyennes » ? À quelle théorie politique est-il possible de les rattacher ? Quelles en sont les expressions concrètes et les différentes expériences pratiques ?
Telles sont les différentes questions sur lesquelles les contributions de cet ouvrage ont apporté un éclairage pluridisciplinaire, contemporain et critique. La multiplication des regards disciplinaires, science politique et droit pour l’essentiel, permet ainsi de croiser les regards sur cet objet d’études, de déplacer, parfois, les frontières et, surtout, de penser de manière globale le phénomène des assemblées citoyennes.
Pour découvrir le sommaire, cliquer ici
15. Solidarité et droit de l’Union européenne - Un principe à l’épreuve
sous la direction de : Estelle Brosset, Rostane Mehdi, Nathalie Rubio
208 p., 3e trimestre 2021
ISBN : 979-10-97578-14-5

Pour accéder à l'ouvrage dans sa version intégrale, cliquer sur ce lien
DOI : https://doi.org/10.4000/books.dice.2737
Les occasions de « tester » la solidarité dans l’Union européenne ont été nombreuses et invitent à s’interroger sur la place et le rôle du droit à cet égard. Le droit de l’Union se présente-t-il comme un vecteur de solidarité ? A-t-il contribué à affermir la constitution d’un espace intégré ? A-t-il laissé au contraire apparaître des failles justifiant un aggiornamento ? C’est précisément l’objet de cet ouvrage que de proposer un bilan du principe de solidarité, de ses formats comme de ses applications dans les principales politiques européennes, depuis le traité de Lisbonne et dans un contexte marqué par de nombreuses crises.
Pour découvrir le sommaire, cliquer ici
Avant propos
Estelle Brosset, Professeure en droit public, Chaire Jean Monnet, Aix Marseille Université,
Université de Toulon, Université Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, CERIC, Aix-en-Provence, France.
Rostane Mehdi, Professeur de droit public, Directeur de Sciences Po Aix, Chaire Jean Monnet
ad personam, UMR DICE-CERIC
Nathalie Rubio, Professeure de droit public, Chaire Jean Monnet, Aix Marseille Université,
Université de Toulon, Université de Pau et des Pays de l’Adour, CNRS, DICE, CERIC,
Aix‑en‑Provence, France
Rostane Mehdi, Professeur de droit public, Directeur de Sciences Po Aix, Chaire Jean Monnet
ad personam, UMR DICE-CERIC
Le « mot » solidarité en droit de l’Union européenne
Karine Abderemane, Maître de conférences en droit public à la faculté Jean Monnet, Université
Paris-Saclay, IEDP EA 2715
Solidarité et clause(s) de respect des identités nationales dans le traité de Lisbonne
Incompatibilité indépassable ou binôme indispensable ?
Xavier Magnon, Professeur de droit public, Aix Marseille Univ, Université de Toulon, Univ Pau
& Pays Adour, CNRS, DICE, ILF, Aix-en-Provence, France
La citoyenneté de l’Union et le titre « Solidarité » de la Charte des droits fondamentaux :
quelles articulations ?
Anastasia Iliopoulou-Penot, Professeur à l’Université Panthéon-Assas, Centre de droit européen
La politique de cohésion post traité de Lisbonne à l’épreuve des crises. Le test COVID
d’une politique emblématique de la solidarité européenne
Nathalie Rubio, Professeure de droit public, Chaire Jean Monnet, Aix Marseille Université,
Université de Toulon, Université de Pau et des Pays de l’Adour, CNRS, DICE, CERIC,
Aix‑en‑Provence, France
La solidarité européenne et les marchés publics conjoints à l’épreuve de la crise sanitaire
Stéphane de La Rosa, Professeur à l’Université Paris-Est Créteil (UPEC), Chaire Jean Monnet
Sur les traces du principe de solidarité en droit de l’Union européenne de l’environnement
Estelle Brosset, Professeure en droit public, Chaire Jean Monnet, Aix Marseille Université,
Université de Toulon, Université Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, CERIC, Aix-en-Provence, France
La politique de l’énergie : l’esprit de solidarité a-t-il été incarné ?
Marie Lamoureux, Agrégée des facultés de droit, Professeur, Aix Marseille Université, Université
de Toulon, Université de Pau et des Pays de l’Adour, CNRS, DICE, CERIC, Aix‑en‑Provence, France
La solidarité intergénérationnelle du traité de Lisbonne : perspectives post-pandémie
Éloïse Gennet, Docteure en droit, Post-doctorante, Aix Marseille Université, Université de Toulon,
Université de Pau et des Pays de l’Adour, CNRS, DICE, CERIC, Aix‑en‑Provence, France
Stabilité et solidarité dans la zone euro
Francesco Martucci, Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II)
Le traité de Lisbonne a-t-il rendu la solidarité possible dans le domaine de la sécurité
et de la défense ?
Fabien Terpan, Maître de conférences HDR à Sciences po Grenoble, Chaire Jean Monnet –
Directeur adjoint du CESICE
Le budget de l’Union, test de la solidarité entre États. Le traité de Lisbonne a-t-il changé
les choses ?
Aymeric Potteau, Professeur de droit public à l’Université de Lille, CRDP-ERDP, EA n° 4487
16. Rethinking Flow Beyond Control - An Outreach Legal Essay
Jean-Sylvestre Bergé
154 p., 3e trimestre 2021
ISBN : 979-10-97578-15-2

Pour accéder à l'ouvrage dans sa version intégrale, cliquer sur ce lien
DOI : https://doi.org/10.4000/books.dice.2527
In his 1978 lecture at the Collège de France on the theme of “Security, territory and population”, Michel Foucault established a link between “circulation”, “security” and “space”. He depicted the approach to circulation in the 17th and 18th centuries, based on legal tools such as international agreements and national or local regulations, as the expression of a desire to secure flows in the different spaces (maritime and terrestrial).
The objective of this legal essay, intended for a broad readership, is to counter this analysis by arguing that, for a certain number of major forms of circulation (release of greenhouse gases, spread of products and organisms of all kinds, pandemics, dissemination of information, movement of persons, data, capital, waste, etc.), mankind is living with an illusion of control.
The question is no longer who controls what, but rather who is suffering the loss of control?
To answer this question, we must rethink our traditional models of circulation and control. All sorts of a priori approaches to circulation can be discussed (magical, liberal, social, ontological, fundamental, modal). As for control, we must recognise that it is perennially exercised in an environment full of holes.
Pour découvrir le sommaire, cliquer ici
14. Systèmes de contrôle de constitutionnalité par voie incidente et protection des personnes en situation de vulnérabilité - Approche de droit comparé
sous la direction de : Caterina Severino et Hubert Alcaraz
584 p., 2e trimestre 2021
ISBN : 979-10-97578-13-8

Pour accéder à l'ouvrage dans sa version intégrale, cliquer sur ce lien
DOI : https://doi.org/10.4000/books.dice.8184
Répondant à l’appel à projets « QPC 2020 » du Conseil constitutionnel, le travail de recherche collectif – dont les résultats sont publiés dans cet ouvrage – entend évaluer l’efficacité de la question prioritaire de constitutionnalité sous l’angle particulier de la protection des personnes en situation de vulnérabilité et selon une approche de droit comparé.
La recherche a ainsi eu pour ambition de dresser un bilan de la jurisprudence QPC du Conseil constitutionnel pour ce qui concerne la protection des personnes vulnérables, en la confrontant avec les procédures similaires existant dans deux pays voisins : l’Italie et l’Espagne.
La protection effective des personnes qui en ont le plus besoin a semblé en effet être un point de vue particulièrement pertinent pour évaluer, de manière générale, l’efficacité du système de la QPC et pour vérifier s’il constitue un véritable progrès dans la défense des droits fondamentaux.
Pour rendre compte de la manière la plus fidèle possible des résultats de cette recherche, l’ouvrage présente, dans une première partie, le rapport de synthèse adressé au Conseil constitutionnel par les porteurs du projet, dans lequel est réalisée la comparaison proprement dite ; puis, dans une seconde partie, les études nationales concernant la jurisprudence constitutionnelle des trois pays étudiés, élaborées par les chercheurs participants au projet scientifique.
Pour découvrir le sommaire, cliquer ici
Préface
Nicole Maestracci, Membre du Conseil constitutionnel, Présidente du Comité scientifique « QPC 2020
Caterina Severino, Professeur à l’Université de Toulon, Université de Toulon, Aix Marseille Univ, Univ Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, CDPC-JCE, Toulon, France
Hubert Alcaraz, Professeur à l’Université de Pau & Pays Adour, Univ Pau & Pays Adour, Aix Marseille Univ, Université de Toulon, CNRS, DICE, IE2IA, Pau, France
Caterina Severino, Professeur à l’Université de Toulon, Université de Toulon, Aix Marseille Univ, Univ Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, CDPC-JCE, Toulon, France
Hubert Alcaraz, Professeur à l’Université de Pau & Pays Adour, Univ Pau & Pays Adour, Aix Marseille Univ, Université de Toulon, CNRS, DICE, IE2IA, Pau, France
I. Le questionnement : la QPC, outil efficace de protection des personnes en situation de vulnérabilité ?
II. Le(s) choix méthodologique(s) : la démarche comparatiste, outil performant d’évaluation de la QPC
III. La Question prioritaire de constitutionnalité protège-t-elle réellement les personnes en situation de vulnérabilité ? Perspective comparative
IV. QPC et protection des personnes vulnérables au prisme du droit comparé
Vulnerabilità, soggetti “deboli” e giustizia costituzionale
Giovanni Serges, Professore ordinario di Diritto Costituzionale, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi «Roma Tre» – Professeur des universités en Droit constitutionnel, Doyen de la Faculté de Droit, Université de «Roma Tre»
Chapitre 1. La vulnérabilité devant les juges constitutionnels français, espagnol et italien
Vulnérabilité et Conseil constitutionnel français
Gaëlle Lichardos, Maître de conférences à la Faculté libre de droit de Toulouse
La protection des personnes en situation de vulnérabilité en Espagne
Marco Berardi, ATER en droit public, Université de Toulon, Aix Marseille Univ, Univ Pau &
Pays Adour, CNRS, DICE, CDPC Jean-Claude Escarras, Toulon, France
La notion de « personne en situation de vulnérabilité » dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle italienne
Giuliano Serges, Docteur en droit public, Universités de Toulon et de Pise ; Membre du CDPC Jean-Claude Escarras; Post-doctorant chargé d’enseignement en droit constitutionnel, Université de « Roma Tre »
Chapitre 2. La protection constitutionnelle des personnes vulnérables en France, en Espagne et en Italie
Quelle protection constitutionnelle de l’enfance ? Les QPC relatives aux mineurs
Mélina Douchy-Oudot, Professeur à l’Université de Toulon, Université de Toulon, Aix Marseille Univ, Univ Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, CDPC-JCE, Toulon, France, Avocat associé Selarl Prudens-juris
El acceso de los menores a la jurisdicción constitucional a través de la cuestión de inconstitucionalidad en el s. xxi
Itziar Gómez Fernández, Référendaire au Tribunal constitutionnel espagnol, Maître de conférences en droit constitutionnel à l’Université Carlos III de Madrid
Una rassegna della giurisprudenza della Corte costituzionale italiana sullo status costituzionale dei minori (2000-2019)
Paolo Passaglia, Professeur de Droit comparé à l’Université de Pise
Dix ans de jurisprudence QPC sur la maladie et le handicap
Laurence Gay, Chargée de recherche au CNRS, Aix Marseille Univ, Université de Toulon, Univ Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, ILF-GERJC, Aix-en-Provence, France
Cuestiones de inconstitucionalidad 2000-2018 relacionadas con el ingreso hospitalario de personas que padecen trastornos psíquicos
Francisco Javier Matia Portilla, Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de Valladolid, javierfacultad@gmail.com
La giurisprudenza della Corte costituzionale italiana in materia di disabili e trattamenti sanitari obbligatori (TSO)
Marina Calamo Specchia, Professore ordinario di Diritto costituzionale comparato nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Section 3. La protection des étrangers
Question prioritaire de constitutionnalité et étrangers
Olivier Lecucq, Professeur à l’Université de Pau & Pays Adour, Directeur de l’Institut d’Études Ibériques et Ibéro-Américaines (UMR DICE 7318), Univ Pau & Pays Adour, Aix Marseille Univ, Université de Toulon, CNRS, DICE, IE2IA, Pau, France
« Questions d’inconstitutionnalité et étrangers »
Olivier Lecucq, Professeur à l’Université de Pau & Pays Adour, Directeur de l’Institut d’Études Ibériques et Ibéro-Américaines (UMR DICE 7318), Univ Pau & Pays Adour, Aix Marseille Univ, Université de Toulon, CNRS, DICE, IE2IA, Pau, France
I diritti degli stranieri di fronte al giudice costituzionale italiano
Laura Montanari, Professore ordinario di Diritto pubblico comparato nell’Università degli Studi di Udine
Francesco Emanuele Grisostolo, Assegnista di ricerca in Diritto pubblico comparato nell’Università degli Studi di Udine
QPC et personnes vulnérables : le cas des gens du voyage en France
Marthe Fatin-Rouge Stefanini, Directrice de recherche au CNRS, Aix Marseille Univ, Université de Toulon, Univ Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, ILF-GERJC, Aix-en-Provence, France
De nomadas a asentados
Fernando Alvarez-Ossorio Micheo, Profesor Titular de Derecho Constitucional, Universidad de Sevilla
La (scarsa) rappresentatività dei soggetti nomadi e senza fissa dimora nella giurisprudenza del Giudice delle leggi italiano
Giovanna Spanò, Assegnista di Ricerca in Diritto Pubblico Comparato, Università di Firenze
Section 5. La protection des travailleurs précaires et des chômeurs
La QPC et les personnes vulnérables
Valérie Bernaud, Maître de conférences HDR à l’Université d’Avignon
La protección de trabajadores vulnerables a través de la cuestión de inconstitucionalidad en España
Miguel Pérez-Moneo, Profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de Barcelona y miembro del Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid y del Congreso de los Diputados
La tutela dei diritti dei lavoratori nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana degli ultimi vent’anni (2000-2019)
Daniele Chinni, Professore associato di lstituzioni di diritto pubblico, Università degli Studi «Roma Tre»
Section 6. La protection des personnes détenues
QPC et détenus en France
Hubert Alcaraz, Professeur à l’Université de Pau & Pays Adour, Univ Pau & Pays Adour, Aix Marseille Univ, Université de Toulon, CNRS, DICE, IE2IA, Pau, France
Question d’inconstitutionnalité et détenus en Espagne
Hubert Alcaraz, Professeur à l’Université de Pau & Pays Adour, Univ Pau & Pays Adour, Aix Marseille Univ, Université de Toulon, CNRS, DICE, IE2IA, Pau, France
I diritti dei detenuti nella più recente giurisprudenza costituzionale italiana
Marco Ruotolo, Professore ordinario di Diritto costituzionale, Università degli Studi « Roma Tre »
Les personnes en situation de vulnérabilité et le filtrage des questions prioritaires de constitutionnalité des cours d’appel civiles (2010-2019)
Nicolas Pauthe, Docteur en droit public (qualification MCF section 02), Enseignant-chercheur contractuel à l’Université Clermont Auvergne, Membre du CMH EA 4232
Personnes en situation de vulnérabilité et juge administratif du premier filtre
Annabelle Pena, Professeur de droit public à l’Université de Toulon, Université de Toulon, Aix Marseille Univ, Univ Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, CDPC-JCE, Toulon, France
Le rôle des associations dans la protection des personnes vulnérables en QPC
Anna-Maria Lecis Cocco Ortu, Maître de conférences en Droit public, Sciences Po Bordeaux, Membre associée, CDPC J.‑C. Escarras, Univ. Toulon, Aix-Marseille Univ., Univ. Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, Toulon, France
13. L’évolution du droit international de l’environnement en Méditerranée
Quelles modalités d’influence pour l’IPBES ?
sous la direction de : Guillaume Futhazar
600 p., 4e trimestre 2020
ISBN : 979-10-97578-12-1

Pour accéder à l'ouvrage dans sa version intégrale, cliquer sur ce lien
Pour retrouver l'ouvrage sur OpenEdition Books : cliquer sur ce lien
DOI : https://doi.org/10.4000/books.dice.14388
Après des décennies de croissance rapide du droit international de l’environnement, il est aujourd’hui crucial d’assurer l’effectivité et l’efficacité de cette branche du droit. Cela implique, entre autres, de garantir la flexibilité et la réactivité des instruments existants. Cette thèse propose d’explorer les mécanismes et phénomènes permettant aux régimes internationaux environnementaux de s’adapter aux évolutions scientifiques, politiques et juridiques en s’appuyant sur un cas d’étude précis : l’influence de la Plateforme intergouvernementale politique et scientifique pour la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) en Méditerranée. L’IPBES a été récemment établie afin de pallier l’inefficacité des politiques environnementales en matière de biodiversité. En partant du postulat du succès de cette plateforme, cette thèse expose les divers moyens juridiques d’influences dont celle-ci dispose dans la région. Nous verrons ainsi que l’expertise institutionnelle des régimes méditerranéens constitue une modalité d’influence directe tandis que les nombreux phénomènes de diffusion normative lui assurent une influence indirecte. La Méditerranée comporte à une échelle réduite tous les enjeux du droit international de l’environnement. Une telle étude permettra donc de mettre en lumière des aspects rarement étudiés de cette branche du droit.
Pour découvrir la table des matières, cliquer ici
Introduction générale
Titre 1. Des voies institutionnelles multiples pour un traitement méditerranéen des conclusions de la Plateforme
Chapitre 1. La diversité des organes experts méditerranéens
Chapitre 2. Le déploiement de l’expertise au sein des régimes méditerranéens
Titre 2. Le décloisonnement de l’expertise méditerranéenne : un facteur pour la prise en compte effective et cohérente des conclusions de la Plateforme
Chapitre 3. L’ouverture de l’expertise méditerranéenne aux organisations non gouvernementales : une voie supplémentaire pour la diffusion des conclusions de l’IPBES
Chapitre 4. L’interconnexion de l’expertise méditerranéenne : une garantie pour un traitement cohérent des conclusions de l’IPBES
Titre 3. Les alignements juridiques entre régimes comme moyen d’influence régionale de l’IPBES
Chapitre 5. Les alignements juridiques, renforcements de l’articulation entre universel et régional
Chapitre 6. Les alignements juridiques et diffusions normatives, expressions de l’influence méditerranéenne de l’Union européenne
Titre 4. L’influence méditerranéenne de l’IPBES par la diffusion de principes environnementaux : l’exemple de l’approche écosystémique
Chapitre 7. Les caractéristiques de l’approche écosystémique en Méditerranée : diffusion et effets
Chapitre 8. La portée juridique du principe d’approche écosystémique en Méditerranée
Conclusion générale
Annexes
Index
Bibliographie
12. L'inapplication du droit
sous la direction de : Romain Le Boeuf et Olivier Le Bot
276 p., 4e trimestre 2020
ISBN : 979-10-97578-11-4

Pour accéder à l'ouvrage dans sa version intégrale, cliquer sur ce lien
DOI : https://doi.org/10.4000/books.dice.11947
Le droit est-il appliqué ? Ainsi formulée, la question est assurément provocante. Certes, nul ne doute de l’existence de comportements contraires aux prescriptions de la règle de droit. Cependant, ces violations ne trouvent-elles pas toujours une réponse assurant in fine le triomphe de l’ordre juridique ? L’acte administratif illégal est annulé, le préjudice réparé, bref, l’ordre des choses rétabli : le coupable puni, c’est la victoire du droit tout autant que l’absence de crime.
Pourtant, certains criminels courent toujours et certains actes illégaux échappent à tout recours. De nombreuses règles – éventuellement d’importance fondamentale – demeurent inappliquées. Les raisons de cette inapplication peuvent en être diverses : inaction des autorités, inertie des victimes et des créanciers, inadéquation des procédures, résignation ou force des habitudes, etc. Comment saisir l’incrédulité envers la règle, le labeur de la démarche, la crainte de représailles qui anéantiraient le gain escompté ? Quelle place réserver aux prescriptions non juridiques – qu’elles soient éthiques, religieuses, économiques ou autres – qui s’interposent au quotidien entre la règle de droit et son application ?
L’objet de cet ouvrage, issu d’une journée d’études organisée à la faculté de droit d’Aix-en-Provence le 13 septembre 2017, est de nourrir la réflexion sur cette thématique en rassemblant les contributions d’une quinzaine d’auteurs sur l’origine, l’ampleur et les manifestations du phénomène.
Pour découvrir la table des matières, cliquer ici
Préface
Marthe Fatin Rouge-Stefanini, Directrice de recherche au CNRS, Directrice de l’UMR DICE, Aix Marseille Univ., Université de Toulon, Univ. Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, ILF-GERJC, Aix-en-Provence, France.
Sandrine Maljean-Dubois, Directrice de recherche au CNRS, Aix-Marseille Université, Université de Toulon, Université de Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, CERIC, Aix-en-Provence, France.
Romain Le Bœuf, Professeur de droit public, Aix-Marseille Université, Université de Toulon, Université de Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, CERIC, Aix-en-Provence, France.
Olivier Le Bot, Professeur de droit public, Aix-Marseille Université, Université de Toulon, Université de Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, ILF-GERJC, Aix-en-Provence, France.
Chapitre I. Le constat de l’inapplication du droit
Institutions politiques et inapplication de la Constitution sous la Ve République
Priscilla Jensel-Monge, Maître de conférences, Aix-Marseille Université, Université de Toulon, Université de Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, ILF-GERJC, Aix-en-Provence, France.
Audrey de Montis, Maitre de conférences à l’Université Rennes I.
L’improbable application de certaines dispositions constitutionnelles
Ferdinand Faye, Docteur en Droit public de l’Université de Reims Champagne Ardenne.
Chapitre II. Les raisons de l’application du droit
Le droit face à la violence : l’inapplication du droit humanitaire
Marie-José Domestici-Met, Professeur émérite, Aix-Marseille Université, Université de Toulon, Université de Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, Aix-en-Provence, France.
Caterina Severino, Professeur, Aix Marseille Univ, Université de Toulon, Univ Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, CDPC Jean-Claude Escarras, Toulon, France.
L’inapplication du droit à l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap : la mise en cause des évaluations ex ante
Mathias Nunes, Doctorant, Aix-Marseille Université, Université de Toulon, Université de Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, ILF-GERJC, Aix-en-Provence, France.
Chapitre I. L’abstention des autorités de contrôle
La tolérance administrative, inapplication condamnable du droit
Fanny Grabias, Maître de conférences à l’Université Lille 2.
L’opportunité des poursuites et l’idée de systématicité de la réponse pénale
Akila Taleb-Karlsson, Maître de conférences, Aix Marseille Univ, Université de Toulon, Univ Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, CDPC Jean-Claude Escarras, Toulon, France.
Le pouvoir de sanction des autorités de régulation : vers la reconnaissance d’un droit à l’inapplication du droit au profit des opérateurs économiques ?
Christos Kaloudas, Docteur en droit de l’Université Paris II.
L’opportunité dans le recours en manquement en droit de l’Union européenne
Nathalie Rubio, Professeur de droit public, Aix-Marseille Université, Université de Toulon, Université de Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, CERIC, Aix-en-Provence, France.
Chapitre II. Les insuffisances des mécanismes juridictionnels
Les récentes réformes de la procédure civile, facteur d’inapplication du droit ?
Marcel Aline, Docteur en droit de l’Université de Strasbourg.
Les recours contentieux délaissés : l’exemple de l’OMC
Habib Ghérari, Professeur de droit public, Aix-Marseille Université, Université de Toulon, Université de Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, CERIC, Aix-en-Provence, France.
L’inapplication des décisions juridictionnelles internationales… au nom du droit
Emanuel Castellarin, Professeur à l’Université de Strasbourg.
Les procès fictifs, une réaction pertinente à l’inapplication du droit ?
Laura Canali, Doctorante, Aix-Marseille Université, Université de Toulon, Université de Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, CERIC, Aix-en-Provence, France.
Conclusions
Jean-Sylvestre Bergé, Professeur à l’Université Lyon 3, Institut Universitaire de France.
11. L’agenciarisation de la politique d’immigration et d’asile face aux enjeux
de la « crise des réfugiés » en Méditerranée
sous la direction de : Rostane Mehdi
158 p., 3e trimestre 2020
ISBN : 979-10-97578-10-7

Pour accéder à l'ouvrage dans sa version intégrale, cliquer sur ce lien
DOI : https://doi.org/10.4000/books.dice.11582
Sous l’effet de la combinaison inédite de facteurs politiques, économiques et sociaux, la Méditerranée est de ces lieux où l’histoire s’est, au cours des dernières décennies, emballée.
C’est dans ce contexte que la « mer du milieu » est devenue l’épicentre de ce que l’on désigne par la formule très approximative de « crise des migrants ». Ces mouvements telluriques n’en sont probablement qu’à leurs prémices.
La force d’évocation négative du syntagme suffit pourtant à éclairer la mise en tension de l’Union et des États qui la constituent. Confrontée à un défi dont on mesure qu’il met à l’épreuve l’unité même de l’Union, celle-ci a fait le choix, somme toute classique, de la novation institutionnelle. Pour anticiper, canaliser et gérer ces flux humains, elle s’est dotée en 2004 de Frontex, devenue l’Agence européenne de gardes-frontières et gardes-côtes. Cette évolution est la déclinaison dans le domaine migratoire d’une dynamique dont l’objet est de moderniser l’action publique afin d’en renforcer, dit-on, l’efficacité. On entre ainsi dans un monde où la qualité des institutions s’apprécie à l’aune de leur « performance » sans être certain que leur aptitude à respecter les droits fondamentaux compte au nombre des indicateurs pertinents. Au fond, la question est posée de savoir si l’Union est parvenue à trouver un point d’équilibre acceptable par l’ensemble de ses membres entre les impératifs de sauvegarde inhérents à sa qualité même d’espace démocratique et l’attractivité d’un éden que les damnés de la terre sont prêts à rejoindre quoi qu’il en coûte.
S’affranchissant des analyses exclusivement disciplinaires, cet ouvrage nous fait pénétrer au coeur des contradictions qui minent le processus d’agenciarisation appréhendé au prisme de la « crise des migrants en Méditerranée ».
Pour découvrir la table des matières, cliquer ici
Rapport introductif
Philippe De Bruycker, Professeur à l’Institut d’études européennes, Université libre de Bruxelles (ULB)
Le Grand Bleu de Frontex
Que disent les métaphores liquides des politiques migratoires européennes ?
Marc Bernardot, Professeur, Aix-Marseille Université, CNRS, LAMES, Aix-en-Provence, France
L’« agenciarisation » de la politique migratoire européenne
Les centres de gestion de crise (hotspots), illustration d’un droit « néomoderne » de la politique migratoire européenne
Pierre Berthelet, Docteur en droit, chercheur associé, Aix Marseille Univ, Université de Toulon, Univ Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, CERIC, Aix-en-Provence, France
La crise en Méditerranée comme facteur d’évolution et de structuration de l’agence Frontex
Chiara Paiano, Doctorante, Aix Marseille Univ, Université de Toulon, Univ Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, CERIC, Aix-en-Provence, France
Agences et opération navale de l’Union européenne dans la « sécuritisation » de l’afflux migratoire en Méditerranée
Philippe Ch.-A. Guillot, Maître de conférences (HDR) en droit public à l’Université de Rouen, Détaché à l’École de l’Air. Membre associé du CUREJ (EA 4703)
Le développement de la coopération des agences ELSJ avec des États tiers
Carole Billet, Maître de Conférences en droit public à l’Université de Nantes, membre de l’UMR CNRS 6297 Droit et changement social
Une agenciarisation en devenir ? Dix ans de réseau européen des migrations
Romain Foucart, Doctorant, Aix Marseille Univ, Université de Toulon, Univ Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, CERIC, Aix-en-Provence, France
Agenciarisation de la politique d’immigration et d’asile et perfectionnement du contrôle par la Cour de justice de l’Union européenne
Ou de la nécessité de franchir de nouveaux caps dans la protection juridictionnelle
Nathalie Rubio, Professeure de droit public, Chaire Jean Monnet, Aix Marseille Univ, Université de Toulon, Univ Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, CERIC, Aix-en-Provence, France
The political accountability of European agencies in the fields of migration and asylum: Frontex and the EASO
Charikleia Vlachou, Maître de conférences, Université d’Orléans
Propos conclusifs
Rostane Mehdi, Directeur de Sciences Po Aix, Agrégé de droit public, Chaire Jean Monnet, UMR DICE (CERIC), Visiting Professor au Collège d’Europe de Bruges.
10. Les grandes affaires climatiques
sous la direction de : Christel Cournil
680 p., 3e trimestre 2020
ISBN : 979-10-97578-09-1

Publié avec le soutien de la Structure fédérative « Les Communs de l'Université Sorbonne Paris Nord »
Pour accéder à l'ouvrage dans sa version intégrale, cliquer sur ce lien
DOI : https://doi.org/10.4000/books.dice.10943
Cet ouvrage est inédit dans sa démarche. En s’inscrivant dans la tradition juridique des célèbres « Grands arrêts », cette publication collective émanant de plus d’une trentaine d’auteurs a pour ambition de mettre en exergue les principaux contours de la « Justice climatique ». L’ouvrage rassemble un échantillon représentatif d’affaires contentieuses rendues ou encore en instance dans le monde sur des questions climatiques très variées (demande indemnitaire de « victimes climatiques », contestation de projets jugés « climaticides », manque d’ambition climatique des États, non-respect des trajectoires de réduction des gaz à effet de serre, demande de désinvestissements dans les énergies fossiles, poursuites d’activistes, etc.).
Offrant un panorama sur une progressive métamorphose de la responsabilité des États et des entreprises, cet ouvrage permet de mieux cerner les arguments juridiques soulevés devant des « juges » très différents (juridiction nationale, tribunal régional, quasi-juridiction nationale ou internationale, mécanisme non juridictionnel, etc.). Ainsi dévoilées « côté à côte », ces affaires climatiques mettent en perspective autant les obstacles particulièrement importants que rencontrent les requérants que les « fenêtres » parfois semblables qu’ouvrent certains juges dans des systèmes juridiques pourtant très différents. Dès lors, les cruciales questions ayant trait à l’évolution de la responsabilité, à la justiciabilité en matière climatique, à l’intérêt à agir, à l’établissement du lien de causalité et à la délicate répartition de la « part » de responsabilité des nombreux émetteurs de gaz à effets de serre, y seront exposées. Sont également retracés les points communs entre les affaires (réception de l’Accord de Paris, invocation des droits fondamentaux, contrôle des actes réglementaires, injonction réparatrice, etc.).
En définitive, cet ouvrage constitue un outil à la fois pratique et théorique à destination des universitaires, des avocats, des magistrats, des étudiants et des juristes des ONG qui travaillent sur la gouvernance climatique ; celle-ci devant désormais inclure les décisions rendues par les juges.
Pour découvrir la table des matières, cliquer ici
Introduction
Christel Cournil, Professeure de droit public (HDR) à Sciences Po Toulouse, membre du LASSP et associée à l’IDPS (Université Sorbonne Paris Nord), membre de la Structure Fédérative « Les Communs »
Titre 1. Les actions curatives contre l’insuffisance de la protection de l’État et de l’Union européenne
1. Massachusetts c. EPA (2007)
Pauline Abadie, Maître de conférences en droit privé, Université Paris Saclay, IDEP
2. Pétitions Inuit Circumpolar Conférence (2005) et Arctic Athabaskan (2013)
Sandrine Maljean-Dubois, Directrice de recherche au CNRS, Aix-Marseille Université, Université de Toulon, Université de Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, CERIC, Aix-en-Provence
3. Urgenda c. Pays-Bas (2015)
Anne-Sophie Tabau, Professeure de droit public à l’Université de La Réunion – membre de l’UMR Espace-Dev 228 et associée au Centre d’études et de recherches internationales et communautaires (CERIC – UMR 7318)
Christel Cournil, Professeure de droit public (HDR) à Sciences Po Toulouse, membre du LASSP et associée à l’IDPS (Université Sorbonne Paris Nord), membre de la Structure Fédérative « Les Communs »
4. Affaire Klimaatzaak (2015)
Delphine Misonne, Chercheur qualifiée au FNRS, Professeure à l’Université Saint-Louis Bruxelles
5. Leghari c. Federation of Pakistan (2015)
Théophile Keïta, Élève-avocat en droit international, École de formation du barreau de Paris
6. Ridhima Pandey c. Union Indienne et autres (2017)
Marellia Auger, Doctorante contractuelle Aix-Marseille Université, Université de Toulon, Université de Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, CERIC, Aix-en-Provence
7. Thomson c. Minister for climate change issues (2017)
Antoine Le Dylio, Avocat au barreau de Paris, Ingénieur en environnement
8. Jeunes c. Colombie (2018)
Camila Perruso, Post-doctorante à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne, (UMR 8103, CNRS Paris 1 Panthéon Sorbonne)
9. Les aînées pour la protection du climat c. la Confédération suisse (2018)
Raphaël Mahaim, Avocat, chargé de cours à l’Université de Lausanne, Député au Parlement du Canton de Vaud (Suisse)
10. Commune de Grande-Synthe et Damien Carême c. l’État français (2019)
Christian Huglo, Avocat à la Cour, Docteur en droit
11. « Les People’s Climate Case » c. Union européenne (2019)
Estelle Brosset, Professeure, Aix Marseille Univ, Université de Toulon, Univ Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, CERIC, Aix-en-Provence, France
Ève Truilhé, Directrice de recherches CNRS, Aix Marseille Univ, Université de Toulon, Univ Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, CERIC, Aix-en-Provence, France
12. Pays-Bas c. Urgenda (2019)
Delphine Misonne, Chercheur qualifiée au FNRS, Professeure à l’Université Saint-Louis Bruxelles
13. Notre affaire à tous et autres c. l’État français (2019)
Christel Cournil, Professeure de droit public, Sciences Po Toulouse, membre du LASSP, associée à l’IDPS (Université Sorbonne Paris Nord), membre de la Structure Fédérative « Les Communs »
Antoine Le Dylio, Avocat au barreau de Paris, ingénieur en environnement
Paul Mougeolle, Doctorant en droit comparé à l’Université de Paris Nanterre (CEJEC) et Potsdam (MRZ)
14. ENvironnement JEUnesse c. Procureur général du Canada (2019)
Géraud de Lassus St-Geniès, Chargé de cours à la Faculté de droit de l’Université Laval (Québec)
15. Familles d’agriculteurs bio et Greenpeace c. Allemagne (2019)
Paul Mougeolle, Doctorant en droit comparé à l’Université de Paris Nanterre (CEJEC) et Potsdam (MRZ), Chercheur Encommuns, chargé du contentieux contre Total SA à Notre affaire à tous
16. Juliana et al. c. États-Unis et al. (2016-2020)
Emnet Gebre, Consultante internationale et Docteure en droit
17. Affaires Greta Thunberg, Teitiota et Torrès (2019-2020)
Christel Cournil, Professeure de droit public, Sciences Po Toulouse, membre du LASSP, associée à l’IDPS (Université Sorbonne Paris Nord), membre de la Structure Fédérative « Les Communs »
Titre 2. Les actions préventives contre des décisions exacerbant le changement climatique
18. Affaire « Paramos » (2016)
Franck Laffaille, Professeur de droit public, Faculté de droit de Villetaneuse (IDPS), Université de Paris XIII (Sorbonne-Paris-Nord)
19. Earthlife Africa Johannesburg c. ministère des Affaires environnementales et autres (2017)
Daniel Owona, Doctorant en droit international à l’Université Catholique d’Afrique Centrale (UCAC), Juriste à Field Legality Advisory Group (FLAG)
20. Push Sweden, Fältbiologerna et autres c. Gouvernement suèdois (2018)
Pau de Vílchez Moragues, Professeur de droit international public et sous-directeur du Laboratoire Interdisciplinaire sur le Changement Climatique de l’Université des Îles Baléares (LINCC UIB)
21. Greenpeace Nordic Ass’n et Nature and Youth c. Ministry of Petroleum and Energy (2018-2020)
Antoine Le Dylio, Avocat au barreau de Paris, Ingénieur en environnement
22. Indigenous Environmental Network c. US Department of State (2018-2019)
Sandy Cassan-Barnel, Juriste, Notre Affaire à Tous (NAAT)
23. Affaires du Triangle de Gonesse (2019)
Marine Fleury, Maîtresse de conférences à l’Université de Picardie Jules Verne, CURAPP, Membre associé de l’Institut des Sciences Juridiques et Philosophiques de la Sorbonne (UMR 8103) et du ClimaLex (GDR 2032)
24. Affaires des extensions des aéroports de Vienne et Londres
Paul Mougeolle, Doctorant en droit comparé sur la vigilance climatique à l’Université de Paris Nanterre (CEJEC) et Potsdam (MRZ), chercheur En-communs, chargé du contentieux contre Total SA à Notre affaire à tous
Titre 1. Les actions curatives en direction des principales entreprises émettrices de gaz à effet de serre
25. American Electric Power Company c. Connecticut (2011)
Pauline Abadie, Maître de conférences en droit privé, Université Paris Saclay, IDEP
26. Native Village Of Kivalina c. Exxon Mobil Corp. (2012)
Pierre Spielewoy, Doctorant en droit international de l’environnement, Centre Universitaire Rouennais d’Études Juridiques (EA 4703), Université de Rouen et Unité Eco-anthropologie (UMR 7206), Muséum National d’Histoire Naturelle, CNRS, Université Paris Diderot
27. Lliuya c. RWE (2016)
Fanny Giansetto, Maître de conférences à l’Université Sorbonne Paris Nord, Membre de l’IRDA et de la Structure Fédérative « Les Communs »
28. Ville d’Oakland et the People of State of California c. BP P.L.C et al. (2018)
Laura Canali, Doctorante en droit public membre du CERIC, Aix-Marseille Université, Université de Toulon, Université Pau & Pays Adour, CNRS, UMR DICE 7318
29. Ville de New York c. BP, Chevron, Conocophillips, Exxonmobil, et Royal Dutch Shell (2018)
Filippo P. Fantozzi, LL.M. Candidate in Climate Change and Energy Law, Pace University School of Law, New York
30. État de Rhode Island c. Chevron et al. (2019)
Filippo P. Fantozzi, LL.M. Candidate in Climate Change and Energy Law, Pace University School of Law, New York
Titre 2. Les actions préventives visant à limiter l’impact climatique
31. Greenpeace Asie du sud-est et autres c. Carbon Majors (2015-2020)
Marine Denis, Doctorante en droit public, Membre de l’IDPS et de la Structure Fédérative « Les Communs », Université Sorbonne Paris Nord
32. Greenpeace Netherlands, Oxfam Novib, Banktrack et Milieudefensie c. Ing Bank (2017)
Catherine Colard-Fabregoule, Maître de conférences (HDR) en droit public, Université Sorbonne Paris Nord, Membre de l’IDPS – Institut de droit, Sciences politiques et sociales et de la Structure Fédérative « Les Communs»
33. Milieudefensie et autres c. Shell (2019)
Louis Duthoit, Juriste, Notre affaire à tous, Chargé de mission, Fédération des usagers de la bicyclette
34. Notre affaire à tous et autres c. Total (2020)
Paul Mougeolle, Doctorant en droit comparé sur la vigilance climatique à l’Université de Paris Nanterre (CEJEC) et Potsdam (MRZ), chercheur En-communs, chargé du contentieux contre Total SA à Notre affaire à tous
35. Affaires « des décrocheurs » (2019-2020)
Antoine Le Dylio, Avocat au barreau de Paris, Ingénieur en environnement
Paul Mougeolle, Doctorant en droit comparé à l’Université de Paris Nanterre (CEJEC) et Potsdam (MRZ)
36. Activistes climatiques c. Crédit suisse et le ministère public (2020)
Raphaël Mahaim, Avocat, Chargé de cours à l’Université de Lausanne et député au Parlement
du Canton de Vaud (Suisse)
Marie-Pomme Moinat, Avocate au barreau du Canton de Vaud (Suisse)
Irène Wettstein, Avocate au barreau du Canton de Vaud (Suisse)
Conclusion
Mathilde Hautereau-Boutonnet, Professeur de droit, Aix-Marseille Université, Université de Toulon, Université de Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, CERIC, Aix-en-Provence
9. Procès et environnement : quelles actions en justice pour l'environnement ?
sous la direction de : Mathilde Hautereau-Boutonnet, Eve Truilhé
148 p., 2e trimestre 2020
ISBN : 979-10-97578-08-4

Pour accéder à l'ouvrage dans sa version intégrale, cliquer sur ce lien
DOI : https://doi.org/10.4000/books.dice.9216
Les travaux publiés dans cet ouvrage sont le fruit de recherches collectives menées en France, à travers l’ensemble des ordres juridiques (constitutionnel, administratif, judiciaire) mais aussi au Japon et au Québec. Il s’agit de porter un regard comparatiste sur les actions en justice en matière de protection de l’environnement, sous le prisme de la stratégie contentieuse. Sont appréhendés tout à la fois les spécificités de tel ou tel type d’action, les difficultés juridiques propres aux actions formées par des associations, les stratégies que celles-ci doivent privilégier ainsi que les risques auxquels elles s’exposent en agissant en justice, les potentialités de l’action de groupe, mais aussi celle de l’octroi de droits à la nature elle-même.
Pour découvrir la table des matières, cliquer ici
Mathilde Hautereau-Boutonnet, Professeur de droit privé, Aix Marseille Univ, Université de Toulon, Univ Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, CERIC, Aix-en-Provence, France
Ève Truilhé, Directrice de recherche au CNRS, Aix Marseille Univ, Université de Toulon, Univ Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, CERIC, Aix-en-Provence, France
Procès et environnement : quelles actions en justice pour l’environnement ?
Sabrina Dupouy, Maître de conférences, Université Clermont Auvergne
La défense de la nature, sujet de droit ou intérêt à protéger ?
Jean-Baptiste Perrier, Professeur à Aix-Marseille Université (LDPSC EA 4690) ; Directeur de l’Institut de sciences pénales et de criminologie
Le choix du juge civil ou du juge pénal en France ?
Olivier Le Bot, Professeur de droit public, Aix Marseille Univ, Université de Toulon, Univ Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, ILF-GERJC, Aix-en-Provence, France
Un procès administratif adapté à la protection de l’environnement ?
Sophie Bourges, Juriste spécialisée en droit de l’environnement, juriste FNE PACA 2014-2018
Les stratégies des ONG. Retour d’expérience de France Nature Environnement (FNE) Provence-Alpes-Côte d’Azur
Marie Lamoureux, Agrégée des facultés de droit, Professeur de droit privé, Aix Marseille Univ, Université de Toulon, Univ Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, CERIC, Aix-en-Provence, France
L’action de groupe environnementale en France
Michel Bélanger, Avocat, Membre du Barreau du Québec, Membre de l’Association du Barreau canadien
L’action collective environnementale au Québec
Paule Halley, Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement, Professeure à la Faculté de droit de l’Université Laval, Québec
Protection des lanceurs d’alerte contre les menaces, les représailles et les poursuites-bâillons. L’expérience canadienne et québécoise
Taiki Kishimoto, Professeur à l’université de Hokkaido
Hiroyuki Oonuki, Professeur à l’université de Chuo
La justice environnementale et l’institutionnalisation du recours associatif dans le domaine de la protection environnementale au Japon
Laurence Gay, Chargée de recherches CNRS HDR, Directrice-adjointe de l’Institut Louis Favoreu-GERJC, Aix Marseille Univ, Université de Toulon, Univ Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, Aix-en-Provence, France
Défendre l’environnement devant le Conseil constitutionnel. Quelle procédure pour servir la Charte de l’environnement ?
8. La consultation en droit public interne
sous la direction de : Fleur Dargent
516 p., 1er trimestre 2020
ISBN : 979-10-97578-06-0

Pour accéder à l'ouvrage dans sa version intégrale, cliquer sur ce lien
DOI : https://doi.org/10.4000/books.dice.8826
Dans son sens courant, la consultation est l’action de s’adresser à quelqu’un pour obtenir un avis, considéré comme une opinion, une information ou une recommandation, mais cette définition s’applique-t-elle à toutes ces procédures ? Si une étude empirique en droit public fait ressortir de nombreuses disparités, elle met en lumière un certain nombre de traits communs utiles à la construction d’une notion juridique.
La consultation répond à un certain nombre de critères. Organiquement, elle est placée entre les mains d’une autorité dotée d’un pouvoir décisionnel. Temporellement, elle a vocation à influer sur une norme en préparation. Matériellement, elle se traduit par un avis qui clôt le processus consultatif. L’aboutissement de la consultation se présente comme un acte non contraignant, dont l’auteur n’est pas l’autorité compétente pour édicter la norme et qui est dépourvu d’effet exécutoire.
La thèse s’attache ensuite à mettre en lumière la tension que subit le phénomène consultatif aujourd’hui, pris entre la reconnaissance de son utilité et la volonté affichée d’en réduire l’utilisation. Substantiel, le mouvement de rationalisation et d’harmonisation des procédures entamé au début du siècle souffre, toutefois, de nombreuses exceptions, malgré l’objectif affiché. Outre la volonté de clarifier le droit, la thèse vise à proposer une harmonisation plus poussée des procédures consultatives en dépit de la subsistance nécessaire de certaines spécificités, notamment en matière juridictionnelle.
Pour découvrir la table des matières, cliquer ici
Introduction générale
Titre 1. Un phénomène juridique
Chapitre I. Un phénomène non contraignant
Chapitre II. Un phénomène normatif ?
Titre 2. Un phénomène identifiable
Chapitre I. La dualité de la consultation
Chapitre II. Une singularisation possible
Titre 1. Le recours à la consultation
Chapitre I. Les fonctions de la consultation
Chapitre II. Les risques de la consultation
Titre 2. La régulation du phénomène consultatif
Chapitre I. Le ralentissement de l’inflation consultative
Chapitre II. La construction d’un droit de la consultation
Conclusion générale
7. Le droit international de la reconnaissance, un instrument de décolonisation et de refondation du droit international ?

sous la direction de : Albane Geslin, Emmanuelle Tourme Jouannet
204 p., 4e trimestre 2019
ISBN : 979-10-97578-07-7

Pour accéder à l'ouvrage dans sa version intégrale, cliquer sur ce lien
DOI : https://doi.org/10.4000/books.dice.8394
Lorsqu’en 2011 est publié Qu’est-ce qu’une société internationale juste ? Le droit international entre développement et reconnaissance, d’Emmanuelle Tourme Jouannet, puis que paraît, l’année suivante son article « Le droit international de la reconnaissance », surgit dans le champ de la recherche française – et plus largement francophone – en droit international un nouveau paradigme, celui de la « reconnaissance ». Les réactions suscitées par ces publications furent vives. Il y eu quelques mécompréhensions du concept même de reconnaissance, et diverses critiques se firent entendre. C’est à l’occasion du premier workshop international du groupe de recherche Justice/Injustice Globale, les 8 et 9 septembre 2016, que fut abordée la question de savoir si le droit international de la reconnaissance pouvait être un instrument de décolonisation et de refondation du droit international.
Pour découvrir la table des matières, cliquer ici
Albane Geslin, Professeure de droit public. Sciences Po Aix - Aix Marseille Univ, Université de Toulon, Univ Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, CERIC, Aix-en-Provence, France
Emmanuelle Tourme Jouannet, Professeure de droit public, École de Droit, Sciences Po, Paris
Propos introductifs – Décoloniser et refonder le droit international au prisme de la reconnaissance
Première partie. Regards théoriques et méthodologiques sur le droit international de la reconnaissance
Albane Geslin, Professeure de droit international public. Sciences Po Aix - Aix Marseille Univ, Université de Toulon, Univ Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, CERIC, Aix-en-Provence, France
La recherche en droit international de la reconnaissance
Quelle(s) posture(s) épistémologique(s) ?
Diane Bernard, Professeure, Université Saint-Louis – Bruxelles
Difficultés à déconstruire et opportunité de refonder le droit (international) à partir du droit (de la reconnaissance)
Jeremy Perelman, Professeur, Directeur de la Clinique, École de Droit, Sciences Po Paris
Une approche critique et pragmatique du droit international des droits humains
Pour une réappropriation par les « subalternes »
Paul Bourgues, Juriste
James Lorimer – La genèse de la notion de reconnaissance en droit international
Sarah Lazaar, Doctorante en droit comparé, École de Droit de la Sorbonne, Paris 1 Panthéon Sorbonne
La reconnaissance des droits fonciers des peuples en Afrique et leur interaction avec les politiques dites « de développement »
Makane Moïse Mbengue, Professeur de droit international à la Faculté de droit de l’Université de Genève ; Professeur affilié à l’Ecole de droit de Sciences Po Paris
Kiara Neri, Maître de conférences HDR, Université Jean Moulin Lyon 3
Le droit international économique comme moyen de « décoloniser » le droit international ?
L’exemple des préférences commerciales
Ademar Pozzatti Junior, Professeur de droit international à l’Université Fédérale de Santa Maria – Brésil
Lydie Kiki-Neme, Assistante en droit public à l’Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo (Côte d’Ivoire)
Droit international de la reconnaissance – Le cas des victimes de guerre à la fin du conflit ivoirien
Joël Radaody, Dirigeant de l’association Exequatur
Reconnaissance et identité collective à Madagascar
Thibaud Baghdadi, Coordinateur juridique du centre de rétention administrative de Nîmes pour l’Association Forum Réfugiés-Cosi
6. Les Organisations internationales et la résolution des conflits post-bipolaires
en Afrique
sous la direction de : Thierry Sèdjro Bidouzo
496 p., 1er trimestre 2019
ISBN : 979-10-97578-05-3

Pour accéder à l'ouvrage dans sa version intégrale, cliquer sur ce lien
DOI : https://doi.org/10.4000/books.dice.7797
Le droit international, dans son rôle de « vigie » ou de « vigile » de la sécurité internationale, est parfois éprouvé par la délicate équation du défi de la paix en Afrique. En effet, depuis que ce continent est devenu « [acteur] de son histoire », – avec le nouveau décor international occasionné par la fin de la période bipolaire –, paradoxalement, il est également devenu un terrain fertile en conflits. En dépit des mutations ou des « dynamiques du droit international », opérées par les Organisations internationales dans la pratique du maintien de la paix, la dynamique évolutive des conflits et leur nature irrégulière, posent bien de difficultés. Et c’est le noeud de ces rapports ambigus entre les Organisations internationales et les conflits en Afrique qu’il convient de tenter de défaire, en en appréhendant tour à tour, leur implication, puis leur contribution à la résolution desdits conflits.
De cette double appréhension, émerge le besoin, dans les stratégies de résolution des conflits, d’une prise en compte aussi bien de la violence visible que de la violence invisible ; celle-ci suppose une réelle connaissance des vrais déterminants conflictuels. D’où la nécessité d’un droit régional africain de maintien de la paix car, la paix objective doit être accompagnée de la paix subjective.
Pour découvrir la table des matières, cliquer ici
Introduction générale
Première partie. L’implication massive des organisations internationales dans la résolution des conflits en Afrique
Titre 1. La diversité des stratégies de maintien de la paix
Chapitre 1. Les mécanismes traditionnels de maintien de la paix
Chapitre 2. Les nouveaux mécanismes de maintien de la paix
Titre 2. La pluralité des acteurs de maintien de la paix
Chapitre 1. La variété des niveaux d’implication des organisations internationales
Chapitre 2. La mise en place des cooperations interinstitutionnelles
Seconde partie. La contribution relative des organisations internationales à la resolution des conflits en Afrique
Titre 1. La mécanique statique des acteurs de maintien de paix
Chapitre 1. Les écueils internes aux Organisations internationales
Chapitre 2. La compléxité des partenariats interinstitutionnels
Titre 2. La dynamique évolutive des conflits
Chapitre 1. La dialectique complexe des nouveaux conflits
Chapitre 2. Une impossibilité quasi-ontologique des Organisations internationales ?
Conclusion
Index
Bibliographie
5. La démocratie connectée : ambitions, enjeux, réalité
sous la direction de : Michaël Bardin, Marthe Fatin-Rouge Stefanini, Priscilla Jensel-Monge et Caterina Severino
146 p., 2ème trimestre 2018
ISBN : 979-10-97578-04-6

Pour accéder à l'ouvrage dans sa version intégrale, cliquer sur ce lien
DOI : https://doi.org/10.4000/books.dice.5837
Présentant une version enrichie de la Journée décentralisée de l’AFDC organisée à Toulon par le CDPC Jean-Claude Escarras et l’ILF-GERJC, en novembre 2016, cet ouvrage explore l’impact réel de la « révolution numérique » qui modifie, chaque jour un peu plus, nos modes de vie. Cette révolution technologique a une incidence sur la vie démocratique et sur le fonctionnement de nos institutions.
Certains assurent déjà qu’internet garantit un meilleur pluralisme de l’information ou expliquent que les blogs, forums et autres réseaux sociaux sont les nouveaux lieux des débats de société. D’autres mettent en avant que ces mêmes réseaux sociaux offrent les moyens aux citoyens d’exercer une sorte de contre-pouvoir. L’Estonie, ou plus récemment la France, ont donné la possibilité aux citoyens de participer à l’écriture de leur Constitution
nationale ou au processus législatif via internet.
Internet semble ainsi offrir de nouveaux outils à la démocratie. Cependant, cette démocratie connectée n’est-elle pas qu’une illusion ? Les représentants sont-ils vraiment plus accessibles ? Les citoyens se sentent-ils réellement plus impliqués ?
Peut-on réellement espérer un renouvellement de la vie démocratique grâce au numérique ? Des risques de dérives semblent poindre. Dès lors, peut-on les éviter ou du moins les anticiper pour mieux les contenir ? L’ensemble de ces questions est abordé tout au long de la journée d’étude dont cet ouvrage est issu.
Pour découvrir la table des matières, cliquer ici
Caterina Severino, Professeur à l’Université de Toulon
Propos introductifs. Ambitions et limites de la démocratie connectée
Jean Gicquel, Professeur émérite de l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)
Propos introductifs à la séance
Ariane Vidal-Naquet, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille
Le citoyen co-législateur : quand, comment, pour quels résultats ?
Jean-Philippe Derosier, Professeur à l’Université de Lille 2 - Droit & Santé
Le numérique comme outil de contrôle des gouvernants
Sophie Lamouroux, Maître de conférences HDR à l’Université d’Aix-Marseille
Garanties démocratiques et numérique
François-Bernard Huyghe, Directeur de recherche à l’IRIS
Numérique : activisme et influence politique
Pascal Jan, Professeur à l’Institut d’Études Politiques de Bordeaux
Propos introductifs à la séance
Michaël Bardin, Maître de conférences à l’Université d’Avignon
Priscilla Jensel-Monge, Maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille
Idris Fassassi, Professeur à l’Université de Picardie Jules Verne
Les effets des réseaux sociaux dans les campagnes électorales américaines
Marthe Fatin-Rouge Stefanini, Directrice de recherches au CNRS, UMR 7318 DICE, ILF-GERJC
Propos conclusifs. Quel avenir pour le citoyen dans la « démocratie numérique » ?
4. Quel droit pour l'adaptation des territoires aux changements climatiques ?
Bilan et perspectives pour l'île de la Réunion
sous la direction de : Anne-Sophie Tabau
272 p., 2ème trimestre 2018
ISBN : 979-10-97578-03-9

Pour accéder à l'ouvrage dans sa version intégrale, cliquer sur ce lien
DOI : https://doi.org/10.4000/books.dice.3937
La recherche collective dont cet ouvrage est le fruit s’est donnée pour ambition de cerner les implications juridiques de l’adaptation des territoires aux changements climatiques. L’équipe s’est appuyée sur l’exemple de l’île de La Réunion pour s’interroger sur les traductions juridiques du discours politique résultant de la COP 21 qui consistait, tout à la fois, à mettre l’accent sur l’adaptation aux effets des changements climatiques et non plus seulement sur l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre, à décentraliser les politiques climatiques de manière à les faire correspondre aux spécificités locales, à adopter une approche transversale de la vulnérabilité des territoires et des populations, et à favoriser les échanges de bonnes pratiques au titre d’une coopération globale. Dans ce contexte, les travaux conduits identifient, dans différentes branches du droit, les expressions de l’adaptation, et déterminent si le droit applicable à La Réunion est adapté à l’enjeu climatique. L’accent est mis sur les processus d’agencement des éléments hétérogènes identifiés comme autant de composantes de l’adaptation à La Réunion, afin de révéler et d’évaluer les mécanismes juridiques qui permettent de faire naître et de stabiliser les attentes normatives des parties prenantes de l’adaptation des territoires aux changements climatiques.
Cette recherche a été financée par le ministère de la Transition écologique et solidaire,
dans le cadre du programme OMERAD (15-MCGOT-GICC-2-CVS-009)
Pour découvrir la table des matières, cliquer ici
Anne-Sophie Tabau, Professeure de droit public, Université de La Réunion, Faculté de droit et d’économie, Membre du Centre d’études juridique (CRJ – EA 14), Membre associée du Centre d’études et de recherches internationales et communautaires (CERIC – UMR 7318)
Introduction générale : Un droit en mouvement pour l’adaptation aux changements climatiques
Partie I. L’intégration en droit de l’objectif d’adaptation aux changements climatiques
Chapitre 1. Les vecteurs d’intégration
Hélène Pongérard-Payet, Maître de conférences HDR en droit public, Université de La Réunion, Faculté de droit et d’économie, Membre du Centre de recherche juridique (CRJ – EA 14)
Loïc Peyen, Docteur en droit public, Chargé d’enseignement, Université de La Réunion, Faculté de droit et d’économie, Membre du Centre de recherche juridique (CRJ – EA 14)
La démocratie locale en matière d’adaptation au changement climatique
Chapitre 2. Les secteurs d’intégration
Audrey Dameron, Docteure en droit public, Chargée d’enseignement, Université de La Réunion, Faculté de droit et d’économie, Membre du Centre de recherche juridique (CRJ – EA 14)
L’adaptation aux changements climatiques par les documents d’urbanisme
Anne-Françoise Zattara-Gros, Maître de conférences HDR en droit privé, Université de La Réunion, Faculté de droit et d’économie, Membre du Centre de recherche juridique (CRJ – EA 14)
Chapitre 1. L’indétermination des responsables
Sandrine Maljean-Dubois, Directrice de recherche au CNRS, UMR 7318 DICE Droits international, comparé, européen, CNRS, Aix-Marseille Université, Université de Toulon, Université de Pau et des pays de l’Adour, CERIC, Aix-en-Provence
Romain Ollard, Professeur de droit privé, Université de La Réunion, Faculté de droit et d’économie, Membre du Centre de recherche juridique (CRJ – EA 14)
La responsabilité pénale en matière d’adaptation aux changements climatiques
Chapitre 2. La responsabilisation des parties prenantes
Safia Cazet, Maître de conférences, Université de La Réunion, Faculté de droit et d’économie, Membre du Centre de recherche juridique (CRJ – EA 14)
La carence des pouvoirs publics dans l’adaptation au changement climatique : quels recours ?
Jonas Knetsch, Professeur de droit privé, Université Jean Monnet Saint-Étienne, Faculté de droit, Membre du Centre de recherches critiques sur le droit (CERCRID - UMR CNRS 5137)
L’assurabilité des risques liés au changement climatique
Olivier Dupéré, Maître de conférences en droit public, Université de La Réunion, Faculté de droit et d’économie, Centre de recherche juridique (CRJ - EA 14)
Marion Lemoine-Schonne, Chargée de recherche au CNRS, Univ Rennes CNRS IODE [Institut de l’Ouest : Droit et Europe] - UMR 6262
Guillaume Futhazar, Doctorant en droit public, Aix-Marseille Université, Membre du Centre d’études et de recherches internationales et communautaires (CERIC – UMR DICE 7318), Membre du Labex OT-Med (n° ANR-11-LABX-0061)
Francesco Sindico, Co-directeur du Strathclyde Centre for Environmental Law and Governance
Ouverture – Les îles, terres de solutions innovantes pour tous les territoires
3. La fabrication du droit de l’Union européenne dans le contexte du « Mieux légiférer »
sous la direction de : Nathalie Rubio
219 p., 1er trimestre 2018
ISBN : 979-10-97578-02-2

Pour accéder à l'ouvrage dans sa version intégrale, cliquer sur ce lien
DOI : https://doi.org/10.4000/books.dice.1308
Dans sa communication du 19 mai 2015, la Commission européenne se dit « déterminée à modifier à la fois ce que fait l’Union européenne (UE) et la façon dont elle le fait ». Elle y présente « de nouvelles mesures destinées à améliorer la réglementation pour obtenir de meilleurs résultats ». Elle souhaite ouvrir davantage le processus d’élaboration des politiques, ainsi que « mieux écouter et mieux interagir avec ceux qui mettent la législation de l’UE en oeuvre et qui en bénéficient ». Il s’agit également de « jeter un regard neuf sur l’ensemble des domaines d’action pour déterminer ceux dans lesquels les mesures existantes demandent à être améliorées». Cette dynamique a été confirmée dans une série d’autres communications et par l’Accord interinstitutionnel du 13 avril 2016. Pourtant, rien ne semble nouveau : cela prolonge un processus ouvert il y a près d’une quinzaine d’années avec le Livre Blanc sur la gouvernance européenne. Les contributions figurant dans cet ouvrage permettent de comprendre les textes relatifs au « Mieux légiférer » adoptés depuis 2015, d’opérer les comparaisons avec des expériences nationales et internationales, de poser un regard critique et d’imaginer des perspectives avec toujours à l’esprit la volonté de trouver les pistes pour tenter de dénouer le noeud gordien de la qualité, de la légitimité et de l’efficacité du droit de l’Union européenne.
Cette recherche a été menée dans le cadre du Centre d’études et de recherches internationales et communautaires (dice.univ-amu.fr/dice/ceric), membre du Centre d’excellence Jean Monnet «L’Europe au Sud» (http://www.cejm-es.eu/) et du Réseau européen Jean Monnet «Solar» (https://www.solar-network.eu/home/).
Pour découvrir la table des matières, cliquer ici
Rubio Nathalie (dir.), La fabrication du droit de l’Union européenne dans le contexte du « Mieux légiférer », Confluence des droits [en ligne]. Aix-en-Provence : Droits International, Comparé et européen, 2017 (généré le ....).
Disponible sur Internet : http://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits
ISBN : 979-10-97578-02-2
Introduction
Propos introductifs, Fabienne Péraldi Leneuf, Professeure à l’École de droit de la Sorbonne
Partie 1. Comprendre le « Mieux légiférer »
Chapitre 1. Le sens du « Mieux légiférer »
Chapitre 2. L’originalité du « mieux légiférer » au regard des expériences internationales et nationales
Partie 2. Mettre en oeuvre le « Mieux légiférer »
Chapitre 1. Approches transversales de la mise en oeuvre du « Mieux légiférer »
Chapitre 2. Approches sectorielles de la mise en oeuvre du « Mieux légiférer »
2. Le contrôle de constitutionnalité des décisions de justice : une nouvelle étape après la QPC?
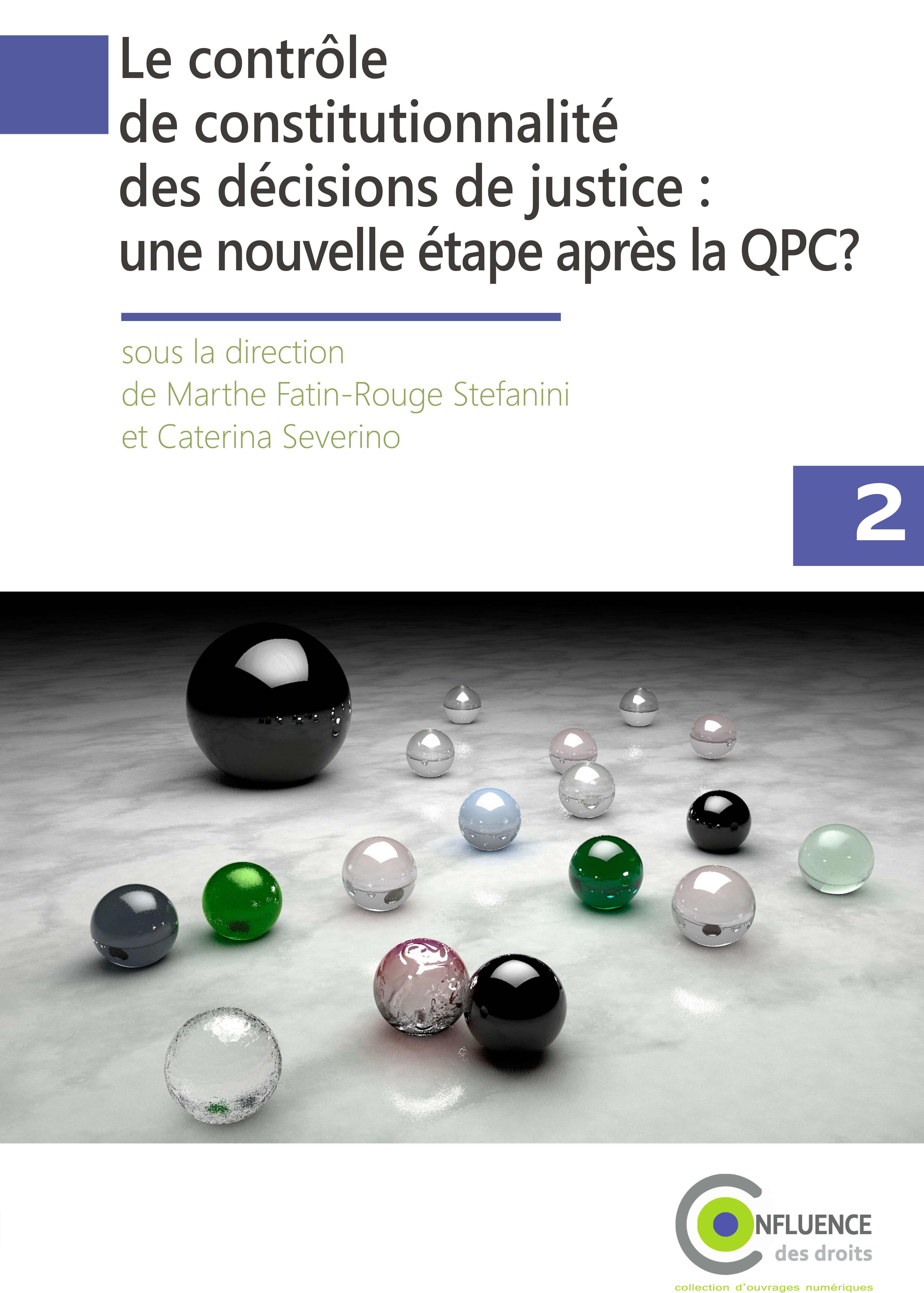
sous la direction de : Marthe Fatin-Rouge Stefanini et Caterina Severino
504 p., 4e trimestre 2017
ISBN : 979-10-97578-01-5

Pour accéder à l'ouvrage dans sa version intégrale, cliquer sur ce lien
DOI : https://doi.org/10.4000/books.dice.5330
Présentant une version enrichie des actes du colloque international organisé à Aix-en-Provence en juin 2016, cet ouvrage explore la possibilité de franchir une nouvelle étape au sein du système de justice constitutionnelle français, par la mise en place d’un contrôle de constitutionnalité des décisions de justice.
Au regard de l’introduction récente de la QPC, un tel questionnement pouvait paraître surprenant, car l’adoption d’une telle procédure a été considérée comme un réel progrès pour l’État de droit français. Toutefois, malgré le succès remarquable de la QPC, il est apparu légitime de se demander si l’objectif affiché par la réforme, à savoir celui d’ouvrir une nouvelle voie de recours aux justiciables pour assurer la protection de leurs droits fondamentaux, avait bien été atteint. Or, l’analyse du fonctionnement concret de la QPC laisse apparaître des difficultés, notamment en ce qui concerne le filtrage opéré par les juridictions administratives et judiciaires, et des angles morts du contrôle de constitutionnalité.
L’objectif poursuivi par le colloque était double : d’une part, tirer les leçons du fonctionnement des systèmes étrangers qui pratiquent un contrôle de la constitutionnalité des décisions de justice, en vérifiant si ce contrôle est une véritable plus-value pour la protection des droits et libertés et, d’autre part, vérifier l’état du système de justice constitutionnelle français après cette réforme capitale, tout en s’interrogeant sur ses possibles perfectionnements.
Pour découvrir la table des matières, cliquer ici
Références électroniques :
Fatin-Rouge Stefanini Marthe, Severino Caterina (dir.), Le contrôle de constitutionnalité des décisions de justice : Une nouvelle étape après la QPC ?, Confluence des droits [en ligne]. Aix-en-Provence : Droits International, Comparé et européen, 2017. Disponible sur Internet :
http://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits.
ISBN : 979-10-97578-01-5
Introduction
Partie 1. Le contrôle de constitutionnalité des décisions de justice par les Cours suprêmes
Chapitre 1. Un contrôle traditionnel pour les cours suprêmes en France
Débats, sous la présidence de Monsieur Guy Canivet
Chapitre 2. Un contrôle naturel dans les systèmes diffus
Michel Hottelier, Professeur à la Faculté de droit de l’Université de Genève, Le contrôle de constitutionnalité des décisions de justice en Suisse ou l’exercice d’un contrôle concret des normes
Débats, sous la présidence de Monsieur Guy Canivet
Chapitre 1. Le contrôle des décisions de justice exercé dans le cadre des recours directs
Débats, sous la présidence de Madame Anne Levade
Chapitre 2. Le contrôle des décisions de justice exercé dans le cadre
des questions préjudicielles
Marc Verdussen, Professeur à l’Université de Louvain (UCL), Centre de recherche sur l’État et la Constitution (JUR I-CRECO), Le contrôle des décisions de justice par la Cour constitutionnelle belge
Jean-Jacques Pardini, Professeur, Directeur-adjoint du CDPC Jean-Claude Escarras, Aix Marseille Univ, Université de Toulon, Univ Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, CDPC Jean-Claude Escarras, Toulon, France, Contrôle de constitutionnalité, interprétation conforme et décisions de justice en Italie : vers une nouvelle configuration des rapports entre la Cour constitutionnelle et les juges ordinaires
Bertrand Mathieu, Professeur à l’École de droit de la Sorbonne Université Paris 1, Le contrôle des décisions de justice par le Conseil constitutionnel français exercé dans le cadre des questions prioritaires de constitutionnalité
Chapitre 3. L’exemple d’un système mixte : le cas du Portugal
Vasco Pereira da Silva, Professeur (Professor catedrático) de la Faculté de droit de l’Université de Lisbonne et Professeur invité de l’École de Lisbonne de la Faculté de droit de l’Université catholique portugaise, Directeur de recherche au CIDP – Centro de Investigação de Direito Público ; Rui Tavares Lanceiro, Maître de conférences (Professor Auxiliar) de la Faculté de droit de l’Université de Lisbonne, Consultant auprès du Tribunal constitutionnel, Directeur de recherche au CIDP – Centro de Investigação de Direito Público, Le contrôle de constitutionnalité des décisions de justice au Portugal
Débats, sous la présidence de Madame Anne Levade
Partie 3. Coexistence des voies de recours et articulation des contrôles
Chapitre 1. Le contrôle par les juridictions suprêmes de leur propre jurisprudence
Le cas de la France – Table ronde
Mathieu Disant, Professeur à l’Université Lyon Saint-Étienne, Jean Monnet, Directeur du CERCRID (UMR CNRS 5137), Le contrôle par les juridictions suprêmes de leur propre jurisprudence – L’exception jurisprudentielle en QPC
Caterina Severino, Maître de conférences HDR, Aix Marseille Univ, Université de Toulon, Univ Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, CDPC Jean-Claude Escarras, Toulon, France, Le contrôle par les Cours suprêmes de leur propre jurisprudence — Approche critique
Débats, sous la présidence de Madame Nicole Belloubet
Chapitre 2. Coexistence entre recours direct et question préjudicielle
Thomas Hochmann, Professeur de droit public à l’Université de Reims Champagne-Ardenne, La coexistence de la question préjudicielle et du recours direct en Allemagne
Chapitre 3. Contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité des décisions de justice
Patrick Gaïa, Professeur, Aix Marseille Univ, Université de Toulon, Univ Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, ILF-GERJC, Aix-en-Provence, France, Contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité des décisions de justice – Quelles distinctions dans les contrôles exercés ?
Débats, sous la présidence de Madame Nicole Belloubet
Partie 4. Les conditions d’une réforme en France, au regard des expériences étrangères
Table ronde, sous la présidence d’André Roux, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille
Discussions
Olivier Le Bot, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille, Aix-Marseille Univ, Université de Toulon, Univ. Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, ILF, Aix-en-Provence, France ; Michel Fromont, Professeur émérite à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; Marc Verdussen, Professeur à l’Université de Louvain (UCL), Centre de recherche sur l’État et la Constitution (JUR I-CRECO) ; Julien Bonnet, Professeur à l’Université de Montpellier, CERCOP ; Laurence Gay, Chargée de recherches CNRS, UMR 7318, DICE, Aix-Marseille Univ, Université de Toulon, Univ. Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, ILF-GERJC, Aix-en-Provence, France ; Yasmine Sylvestre, Docteur en droit public à l’Université des Antilles et de la Guyane, Membre associé de LC2S ; Paolo Passaglia, Professeur à l’Université de Pise ; coordonnateur scientifique pour le droit comparé du Service des Études de la Cour constitutionnelle de la République italienne ; Alexandre Viala, Professeur à l’Université de Montpellier, Directeur du CERCOP ; Ariane Vidal Naquet, Professeur, Aix Marseille Univ, Université de Toulon, Univ Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, ILF-GERJC, Aix-en-Provence, France ; Xavier Magnon, Professeur à l’Université de Toulouse
Propos conclusifs
Marthe Fatin-Rouge Stefanini et Caterina Severino
1. Circulations de normes et réseaux d’acteurs dans la g ouvernance internationale de l’environnement
ouvernance internationale de l’environnement
sous la direction de : Sandrine Maljean-Dubois
212 p., 1er semestre 2017
ISBN : 979-10-97578-00-8

Pour accéder à l'ouvrage dans sa version intégrale, cliquer sur ce lien.
DOI : https://doi.org/10.4000/books.dice.2585
La gouvernance internationale de l’environnement s’est construite par l’émergence progressive
d’espaces juridiques et institutionnels relativement autonomes et non hiérarchisés. Des « régimes » spécialisés ont ainsi proliféré au gré de l’identification de nouvelles menaces
et de nouveaux problèmes à résoudre. Ils se comptent aujourd’hui par dizaines, si bien que la question de la cohérence de ce paysage fragmenté s’est rapidement posée. La multiplication des régimes entraine par définition des concurrences, collisions, doubles emplois de plus en plus fréquents. À cela s’est ajoutée la prise de conscience que les enjeux
environnementaux sont étroitement interconnectés, comme le montrent les relations entre la lutte contre les changements climatiques d’une part et la protection de la couche d’ozone, la conservation de la biodiversité, la désertification, la protection des forêts ou des océans d’autre part. Dès lors, une gouvernance trop fragmentée ne peut être effective, car elle risque de conduire à défaire d’un côté ce que l’on fait de l’autre. Les États peuvent par ailleurs instrumentaliser la fragmentation, jouant tel régime contre tel autre, en fonction de leurs intérêts nationaux. Après avoir mis en évidence les phénomènes de circulations de normes et d’acteurs entre ces régimes, les auteurs de cet ouvrage pluridisciplinaire réfléchissent
aux voies et moyens de les accompagner, voire de les amplifier dans l’objectif de « dé »fragmenter la gouvernance internationale de l’environnement et d’assurer ainsi une meilleure effectivité des politiques conduites.
Cette recherche a été financée par l’Agence nationale de la recherche dans le cadre du projet CIRCULEX <ANR-12-GLOB-0001-03 CIRCULEX>.
Pour découvrir le sommaire, cliquer ici
Pour découvrir la table des matières, cliquer ici
Références électroniques :
Maljean-Dubois Sandrine (dir.), Circulations de normes et réseaux d’acteurs dans la
gouvernance internationale de l’environnement, Confluence des droits [en ligne]. Aix-en-
Provence : Droits International, Comparé et européen, 2017 (généré le ....). Disponible sur
Internet : http://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits. ISBN : 979-
10-97578-00-8.
Introduction