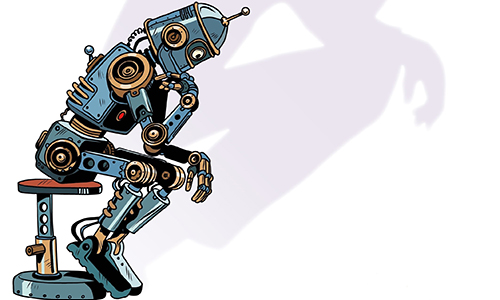Favoriser les savoirs et questionnements des élèves citoyens-acteurs d'aujourd'hui et de demain
Transhumanisme et droit
Depuis bien longtemps, l’acquisition de connaissances, de savoirs, de pratiques relevant des sciences et techniques participe au développement humain comme à l’action de l’homme sur son environnement. Dans ce contexte, le transhumanisme peut être défini comme l’amélioration des capacités humaines par l’utilisation des sciences et techniques intégrées au corps. On peut considérer qu’il existe trois dimensions du transhumanisme : l’amélioration de la qualité de vie ; l’amélioration des performances individuelles ; la transcendance de l’espèce humaine ou posthumanisme (qui constitue la forme la plus poussée du transhumanisme et peut conduire à la création d’entités ou d’intelligences artificielles « supérieures »). Angoisses, espoirs, passions, enjeux de pouvoirs se mêlent autour du transhumanisme et du posthumanisme, fortement médiatisés, vis-à-vis de leur impact sur le monde de demain.
Le cadre juridique peut faciliter ou freiner le développement du transhumanisme. Mais, dans tous les cas, son rôle est de l’encadrer, de le réguler pour que les valeurs communes qui sont chères à l’espèce humaine soient respectées. À cette fin, un débat sociétal est nécessaire.
Ce projet a trois objectifs principaux :
- l’obtention de données qualitatives sur les idées, opinions et questions des élèves du secondaire à travers des exemples concrets liant le droit avec les trois dimensions du transhumanisme dans trois domaines : la santé et l’amélioration de la qualité de vie, le sport et l’amélioration des performances individuelles, la procréation et la transcendance de l’espèce dans sa création et sa fin de vie.
- la participation des élèves à la conférence débat sur la thématique « Transhumanisme : de nouveaux droits ? »
- la sensibilisation des collégiens et lycéens au rôle social du droit et à leur propre rôle de citoyens acteurs du débat public.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site ELSIBI : Ethical, Legal and Social Implications of Biomedical Innovations